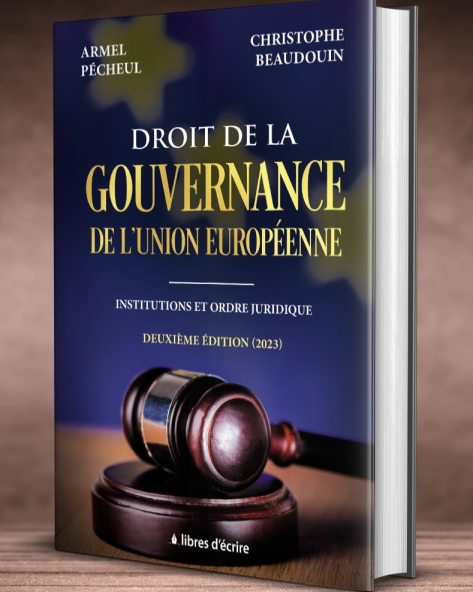par Georges Berthu, ancien député européen
Image tirée du film "The Master" de Paul Thomas Anderson
L’Observatoire de l’Europe vient d’avoir la bonne idée de republier des extraits du grand discours de Jimmy Goldsmith, le 28 mai 1994, porte de Versailles à Paris. Nous étions alors dans la dernière ligne droite de la campagne des élections européennes à l’issue desquelles la liste menée par Philippe de Villiers et Jimmy Goldsmith allait réussir une remarquable percée.
Nos souvenirs émus de ces instants exceptionnels sont aussi teintés de regrets. Car déjà ce discours d’une étonnante lucidité prévoyait tous les maux qu’allait engendrer la politique commerciale laxiste de l’Union Européenne, maux que nous n’avons pas réussi à éviter et dans lesquels nos peuples se débattent et souffrent aujourd’hui.
Jimmy Goldsmith, milliardaire engagé sur tous les continents, connaissait mieux que personne les rouages de la mondialisation. Il les connaissait bien mieux, d’ailleurs, que les politiciens inconscients qui nous ont poussés à ouvrir nos frontières sans discernement. Jimmy Goldsmith était aussi mieux placé que personne pour tirer un profit personnel de cette ouverture. Et pourtant, avec un total désintéressement, il avertissait les Européens des dangers à venir.
Hélas, Jimmy est décédé prématurément en 1997. Philippe de Villiers s’est retrouvé seul, face à un adversaire puissant et manipulateur, la finance internationale, téléguidant une multitude de nains politiques et de faux experts qui criaient sur tous les tons qu’il fallait démanteler nos frontières, toujours davantage, afin de libérer la croissance et l’emploi.
Il est en effet prouvé, archi-prouvé, nous le savons bien, que le libre échange est avantageux pour toutes les parties. Il n’a jamais été question pour nous de le contester. Position bien différente de celle de l’extrême-gauche, qui voudrait profiter de l’occasion pour remettre en cause les fondements du marché. Ce serait évidemment une grave erreur.
Jimmy Goldsmith le savait, lui qui était un libéral convaincu. Dans son discours du 28 mai, il appelait d’ailleurs de ses vœux un « grand marché libéral européen ». Mais lorsqu’il réclamait des protections extérieures pour ce marché, voulait-il arrêter le libéralisme économique aux frontières de l’Europe ? Pas du tout. C’est là qu’il convient de donner une explication un peu plus approfondie.
Le véritable libre échange
La théorie libérale a depuis longtemps montré qu’au jeu du libre échange tout le monde est gagnant. A la limite, même si un pays était plus efficace dans la fabrication de tous les produits, il aurait encore intérêt à commercer avec d’autres, en se spécialisant dans les fabrications où il détient l’avantage comparatif le plus grand.
Nous savons aussi que ce libre échange peut encore fonctionner positivement même si les pays tiers subventionnent leurs exportations, car de cette manière ils nous donnent de l’argent, en quelque sorte, pour que nous achetions leurs produits. Ils s’arrêteront bien de nous en donner le jour où ils seront ruinés et où ils s’apercevront qu’ils nous font de coûteux cadeaux.
Nous savons encore que si nous cherchons à imposer des droits de douane sur un produit particulier qui nous concurrence trop violemment, nous risquons de nous attirer des mesures de rétorsion et ainsi, de proche en proche, de briser tout l’enchaînement positif du libre échange. C’est d’ailleurs encore plus vrai aujourd’hui où les économies sont devenues très imbriquées les une dans les autres.
Nous savons tout cela, et même nous le savions depuis le début. Jimmy Goldsmith lui aussi le savait. Et pourtant il expliquait que dans toute cette théorie, il y avait une insuffisance. La théorie n’est pas fausse, mais elle a besoin d’être complétée.
Tout repose en effet sur un présupposé implicite : que les partenaires jouent à peu près à armes égales. Mais si par exemple le pays tiers qui subventionne ses exportations dispose d’une réserve d’argent illimitée, il ne s’arrêtera pas avant d’avoir ruiné toutes nos industries. Or nous en sommes bien là. Il faut en effet considérer la particularité de la situation présente : nos nouveaux partenaires asiatiques disposent d’une immense réserve de main d’œuvre à bas coût, ce qui équivaut à une capacité de subventionnement illimitée de leurs produits, accompagnée de transports faciles.
C’est là le grand fait nouveau du commerce international des dernières décennies, qui le rend non comparable à tout ce que l’on a connu auparavant.
A ce stade du raisonnement, il faut faire intervenir une autre notion : la limitation de l’information des agents sur le marché. Certes, là aussi, la théorie a depuis longtemps intégré cette idée. Nous savons qu’aucun acte d’échange de la vie réelle ne se produit dans un milieu pur et parfait. On constate en réalité des frictions, des imperfections de la connaissance de chacun, qui peuvent motiver des actes individuels sous-optimaux, mais sans pour autant remettre en cause l’idée que, globalement, l’ensemble des actes libres produit le meilleur équilibre général possible.
Toutefois, dans quelques cas, le fait que les agents, dans leur ensemble, ne prennent pas en compte certaines informations, parce qu’elles sont inconnues ou dissimulées, finit par bloquer le système. C’est le cas de biens collectifs disponibles en quantité limitée, comme l’eau des nappes phréatiques. Chaque agriculteur a un intérêt individuel à pomper la plus grande quantité d’eau possible pour irriguer ses cultures, tout en épandant des pesticides qui accroissent son rendement personnel tout en rendant l’eau imbuvable pour les consommateurs. Le dommage réel causé à la collectivité n’est que peu facturé à l’agriculteur. Laissé à lui-même, dans ces conditions, la marché va dans le mur : la nappe s’épuise, elle est de plus en plus polluée, et au total la collectivité doit subir des coûts de dépollution ou de recherche d’eau potable qui sont bien supérieurs au bénéfice supplémentaire tiré par l’agriculteur de son utilisation immodérée.
Dans un tel cas, une régulation par la puissance publique, qui a pour but d’obliger à la réintégration des coûts cachés, ne contredit pas le marché. Au contraire, elle le redresse et elle le sauve.
Il en va de même pour la problématique du commerce extérieur : les consommateurs ne voient pas les coûts cachés qu’engendrent pour la collectivité les produits importés à bas prix. Deux effets pervers se combinent : d’une part, la subvention cachée dans les prix des importations est illimitée (ou ne prendra fin que lorsque les consommateurs chinois auront atteint notre niveau de vie, ce qui n’est pas pour demain) ; d’autre part le tissu industriel n’a plus les moyens de se renouveler et devient peu ou prou un bien collectif limité. Nous nous trouvons pris dans une tenaille : comme la nappe phréatique se détruit, le système industriel et social des pays européens est en train de se désintégrer.
Encore une fois, n’accusons pas le marché. Accusons plutôt l’aveuglement de nos politiciens.
Maintenant, examinons d’un peu plus près le fonctionnement des effets pervers que nous venons d’identifier.
Les coûts cachés du commerce international
Chaque consommateur a intérêt à se procurer les produits dont il a besoin au plus bas prix possible, à qualité égale, même s’ils sont fabriqués à l’autre bout du monde. Mais si, par exemple, le processus de production de ces biens détruit l’environnement dans un pays lointain, le coût consécutif, pour l’ensemble des habitants de la planète, ne sera pris en compte par personne : chez les uns, l’environnement naturel sera détruit, chez les autres c’est l’économie et la société qui souffriront des dégâts infligés par les importations à prix artificiellement bas. Car les produits ainsi importés dans les pays développés dévasteront des industries locales qui auront le tort de travailler sur des bases, réglementaires ou non, plus équitables.
Autre aspect du même problème : chaque consommateur européen a un intérêt individuel à faire l’acquisition de produits le moins chers possible, grâce à des coûts salariaux le plus bas possibles. Mais croyant faire ainsi un calcul rationnel, il occasionne en réalité des coûts cachés qui seront supportés plus ou moins bien par la collectivité tout entière : chômage endémique, « désaménagement » du territoire et coûts consécutifs divers (santé, sécurité, rupture de familles, etc.).
Là encore, qu’on ne nous accuse pas d’ignorer les lois du marché : nous savons bien que toute situation concurrentielle détruit les entreprises les plus faibles et qu’il faut voir là un phénomène de destruction créatrice finalement salutaire pour l’économie, comme pour le pouvoir d’achat des consommateurs. Bien sûr, ces destructions d’entreprises engendrent aussi pour la collectivité des coûts bien réels qu’il ne faut pas oublier : indemnités de chômage, formation, reconversion, déplacement des familles… Mais en règle générale ces coûts, répartis sur l’ensemble des citoyens, sont supportable, et en tout cas restent inférieurs aux avantages globaux que procure pour tous l’existence d’une situation concurrentielle. Tout cela, donc, ne remet pas en cause l’intérêt du libre échange.
Mais connaissant cette loi générale du marché, nous ne devons pas nous arrêter là. Comment cette règle générale s’applique-t-elle aujourd’hui, dans le cas des échanges commerciaux entre pays développés et pays émergents ?Dans ce cas précis, les subventionnements ou quasi-subventionnements illimités opérés par les pays émergents aboutissent, dans les pays développés, à des destructions d’entreprises massives et à des coûts consécutifs énormes. Comme toujours en cas de situation concurrentielle, ces coûts consécutifs sont déconnectés de l’acte d’achat de chaque consommateur, qui individuellement n’a pas à les supporter dans leur intégralité. Mais à la différence du cas général, les coûts ici sont énormes. Ce n’est plus une simple friction que la collectivité peut prendre en charge sans difficulté, c’est au contraire une charge démesurée qui bloque tout le système.
On voit donc que les effets pervers identifiés aujourd’hui dans l’échange international - subventionnements illimités, limitation de l’information, non-imputation à chacun de l’ensemble des coûts qu’il engendre par ses actes d’achat – aboutissent à une situation globale totalement ingérable.
Nous sommes devant un cas d’impasse du marché, due non pas au marché lui-même, mais à la démission de l’État qui ne joue pas son rôle. Il est en effet nécessaire, dans un cas comme celui-là, que l’État intervienne, aux frontières nationales ou à celles de l’Union Européenne, pour rétablir la vérité des prix. Le marché peut supporter des petites frictions, il ne peut pas supporter des distorsions massives. Il faut donc que l’État ajoute aux produits importés des droits de douane qui obligeront l’acheteur à supporter lui-même les coûts indirects ou invisibles qu’autrement il transfère sans le savoir à la collectivité.
Nous pouvons maintenant donner quelques définitions de notions que nous utilisons : le libre-échangisme consiste à croire que le libre échange international nécessite absolument la disparition des contrôles et des frontières ; l’étatisme croit au contraire que, le libre échange étant une imposture, toute relation saine entre les agents économiques a besoin d’être encadrée par la réglementation. L’étatisme et le libre échangisme sont donc deux dogmatismes symétriquement opposés.
Le véritable libre échange, celui que nous défendons ici, se méfie certes des interventions de l’État, car on ne voit pas pourquoi les fonctionnaires seraient omniscients, ou en tout cas plus savants que le marché. Mais il n’exclut pas non plus que dans certains cas précis, dont nous venons de citer des exemples, l’État ne doive intervenir pour permettre au libre échange de fonctionner correctement.
Dans de tels cas, les protections qui peuvent être instituées ne sont pas des folies arbitraires et contreproductives, comme le clament les profiteurs du libre-échangisme sans régulation. Elles rétablissent au contraire le véritable libre échange, celui qui permet aux consommateurs de choisir leurs achats en payant leurs vrais prix. Voilà pourquoi Jimmy Goldsmith était à son époque un véritable libéral, et un homme clairvoyant.
Nos souvenirs émus de ces instants exceptionnels sont aussi teintés de regrets. Car déjà ce discours d’une étonnante lucidité prévoyait tous les maux qu’allait engendrer la politique commerciale laxiste de l’Union Européenne, maux que nous n’avons pas réussi à éviter et dans lesquels nos peuples se débattent et souffrent aujourd’hui.
Jimmy Goldsmith, milliardaire engagé sur tous les continents, connaissait mieux que personne les rouages de la mondialisation. Il les connaissait bien mieux, d’ailleurs, que les politiciens inconscients qui nous ont poussés à ouvrir nos frontières sans discernement. Jimmy Goldsmith était aussi mieux placé que personne pour tirer un profit personnel de cette ouverture. Et pourtant, avec un total désintéressement, il avertissait les Européens des dangers à venir.
Hélas, Jimmy est décédé prématurément en 1997. Philippe de Villiers s’est retrouvé seul, face à un adversaire puissant et manipulateur, la finance internationale, téléguidant une multitude de nains politiques et de faux experts qui criaient sur tous les tons qu’il fallait démanteler nos frontières, toujours davantage, afin de libérer la croissance et l’emploi.
Il est en effet prouvé, archi-prouvé, nous le savons bien, que le libre échange est avantageux pour toutes les parties. Il n’a jamais été question pour nous de le contester. Position bien différente de celle de l’extrême-gauche, qui voudrait profiter de l’occasion pour remettre en cause les fondements du marché. Ce serait évidemment une grave erreur.
Jimmy Goldsmith le savait, lui qui était un libéral convaincu. Dans son discours du 28 mai, il appelait d’ailleurs de ses vœux un « grand marché libéral européen ». Mais lorsqu’il réclamait des protections extérieures pour ce marché, voulait-il arrêter le libéralisme économique aux frontières de l’Europe ? Pas du tout. C’est là qu’il convient de donner une explication un peu plus approfondie.
Le véritable libre échange
La théorie libérale a depuis longtemps montré qu’au jeu du libre échange tout le monde est gagnant. A la limite, même si un pays était plus efficace dans la fabrication de tous les produits, il aurait encore intérêt à commercer avec d’autres, en se spécialisant dans les fabrications où il détient l’avantage comparatif le plus grand.
Nous savons aussi que ce libre échange peut encore fonctionner positivement même si les pays tiers subventionnent leurs exportations, car de cette manière ils nous donnent de l’argent, en quelque sorte, pour que nous achetions leurs produits. Ils s’arrêteront bien de nous en donner le jour où ils seront ruinés et où ils s’apercevront qu’ils nous font de coûteux cadeaux.
Nous savons encore que si nous cherchons à imposer des droits de douane sur un produit particulier qui nous concurrence trop violemment, nous risquons de nous attirer des mesures de rétorsion et ainsi, de proche en proche, de briser tout l’enchaînement positif du libre échange. C’est d’ailleurs encore plus vrai aujourd’hui où les économies sont devenues très imbriquées les une dans les autres.
Nous savons tout cela, et même nous le savions depuis le début. Jimmy Goldsmith lui aussi le savait. Et pourtant il expliquait que dans toute cette théorie, il y avait une insuffisance. La théorie n’est pas fausse, mais elle a besoin d’être complétée.
Tout repose en effet sur un présupposé implicite : que les partenaires jouent à peu près à armes égales. Mais si par exemple le pays tiers qui subventionne ses exportations dispose d’une réserve d’argent illimitée, il ne s’arrêtera pas avant d’avoir ruiné toutes nos industries. Or nous en sommes bien là. Il faut en effet considérer la particularité de la situation présente : nos nouveaux partenaires asiatiques disposent d’une immense réserve de main d’œuvre à bas coût, ce qui équivaut à une capacité de subventionnement illimitée de leurs produits, accompagnée de transports faciles.
C’est là le grand fait nouveau du commerce international des dernières décennies, qui le rend non comparable à tout ce que l’on a connu auparavant.
A ce stade du raisonnement, il faut faire intervenir une autre notion : la limitation de l’information des agents sur le marché. Certes, là aussi, la théorie a depuis longtemps intégré cette idée. Nous savons qu’aucun acte d’échange de la vie réelle ne se produit dans un milieu pur et parfait. On constate en réalité des frictions, des imperfections de la connaissance de chacun, qui peuvent motiver des actes individuels sous-optimaux, mais sans pour autant remettre en cause l’idée que, globalement, l’ensemble des actes libres produit le meilleur équilibre général possible.
Toutefois, dans quelques cas, le fait que les agents, dans leur ensemble, ne prennent pas en compte certaines informations, parce qu’elles sont inconnues ou dissimulées, finit par bloquer le système. C’est le cas de biens collectifs disponibles en quantité limitée, comme l’eau des nappes phréatiques. Chaque agriculteur a un intérêt individuel à pomper la plus grande quantité d’eau possible pour irriguer ses cultures, tout en épandant des pesticides qui accroissent son rendement personnel tout en rendant l’eau imbuvable pour les consommateurs. Le dommage réel causé à la collectivité n’est que peu facturé à l’agriculteur. Laissé à lui-même, dans ces conditions, la marché va dans le mur : la nappe s’épuise, elle est de plus en plus polluée, et au total la collectivité doit subir des coûts de dépollution ou de recherche d’eau potable qui sont bien supérieurs au bénéfice supplémentaire tiré par l’agriculteur de son utilisation immodérée.
Dans un tel cas, une régulation par la puissance publique, qui a pour but d’obliger à la réintégration des coûts cachés, ne contredit pas le marché. Au contraire, elle le redresse et elle le sauve.
Il en va de même pour la problématique du commerce extérieur : les consommateurs ne voient pas les coûts cachés qu’engendrent pour la collectivité les produits importés à bas prix. Deux effets pervers se combinent : d’une part, la subvention cachée dans les prix des importations est illimitée (ou ne prendra fin que lorsque les consommateurs chinois auront atteint notre niveau de vie, ce qui n’est pas pour demain) ; d’autre part le tissu industriel n’a plus les moyens de se renouveler et devient peu ou prou un bien collectif limité. Nous nous trouvons pris dans une tenaille : comme la nappe phréatique se détruit, le système industriel et social des pays européens est en train de se désintégrer.
Encore une fois, n’accusons pas le marché. Accusons plutôt l’aveuglement de nos politiciens.
Maintenant, examinons d’un peu plus près le fonctionnement des effets pervers que nous venons d’identifier.
Les coûts cachés du commerce international
Chaque consommateur a intérêt à se procurer les produits dont il a besoin au plus bas prix possible, à qualité égale, même s’ils sont fabriqués à l’autre bout du monde. Mais si, par exemple, le processus de production de ces biens détruit l’environnement dans un pays lointain, le coût consécutif, pour l’ensemble des habitants de la planète, ne sera pris en compte par personne : chez les uns, l’environnement naturel sera détruit, chez les autres c’est l’économie et la société qui souffriront des dégâts infligés par les importations à prix artificiellement bas. Car les produits ainsi importés dans les pays développés dévasteront des industries locales qui auront le tort de travailler sur des bases, réglementaires ou non, plus équitables.
Autre aspect du même problème : chaque consommateur européen a un intérêt individuel à faire l’acquisition de produits le moins chers possible, grâce à des coûts salariaux le plus bas possibles. Mais croyant faire ainsi un calcul rationnel, il occasionne en réalité des coûts cachés qui seront supportés plus ou moins bien par la collectivité tout entière : chômage endémique, « désaménagement » du territoire et coûts consécutifs divers (santé, sécurité, rupture de familles, etc.).
Là encore, qu’on ne nous accuse pas d’ignorer les lois du marché : nous savons bien que toute situation concurrentielle détruit les entreprises les plus faibles et qu’il faut voir là un phénomène de destruction créatrice finalement salutaire pour l’économie, comme pour le pouvoir d’achat des consommateurs. Bien sûr, ces destructions d’entreprises engendrent aussi pour la collectivité des coûts bien réels qu’il ne faut pas oublier : indemnités de chômage, formation, reconversion, déplacement des familles… Mais en règle générale ces coûts, répartis sur l’ensemble des citoyens, sont supportable, et en tout cas restent inférieurs aux avantages globaux que procure pour tous l’existence d’une situation concurrentielle. Tout cela, donc, ne remet pas en cause l’intérêt du libre échange.
Mais connaissant cette loi générale du marché, nous ne devons pas nous arrêter là. Comment cette règle générale s’applique-t-elle aujourd’hui, dans le cas des échanges commerciaux entre pays développés et pays émergents ?Dans ce cas précis, les subventionnements ou quasi-subventionnements illimités opérés par les pays émergents aboutissent, dans les pays développés, à des destructions d’entreprises massives et à des coûts consécutifs énormes. Comme toujours en cas de situation concurrentielle, ces coûts consécutifs sont déconnectés de l’acte d’achat de chaque consommateur, qui individuellement n’a pas à les supporter dans leur intégralité. Mais à la différence du cas général, les coûts ici sont énormes. Ce n’est plus une simple friction que la collectivité peut prendre en charge sans difficulté, c’est au contraire une charge démesurée qui bloque tout le système.
On voit donc que les effets pervers identifiés aujourd’hui dans l’échange international - subventionnements illimités, limitation de l’information, non-imputation à chacun de l’ensemble des coûts qu’il engendre par ses actes d’achat – aboutissent à une situation globale totalement ingérable.
Nous sommes devant un cas d’impasse du marché, due non pas au marché lui-même, mais à la démission de l’État qui ne joue pas son rôle. Il est en effet nécessaire, dans un cas comme celui-là, que l’État intervienne, aux frontières nationales ou à celles de l’Union Européenne, pour rétablir la vérité des prix. Le marché peut supporter des petites frictions, il ne peut pas supporter des distorsions massives. Il faut donc que l’État ajoute aux produits importés des droits de douane qui obligeront l’acheteur à supporter lui-même les coûts indirects ou invisibles qu’autrement il transfère sans le savoir à la collectivité.
Nous pouvons maintenant donner quelques définitions de notions que nous utilisons : le libre-échangisme consiste à croire que le libre échange international nécessite absolument la disparition des contrôles et des frontières ; l’étatisme croit au contraire que, le libre échange étant une imposture, toute relation saine entre les agents économiques a besoin d’être encadrée par la réglementation. L’étatisme et le libre échangisme sont donc deux dogmatismes symétriquement opposés.
Le véritable libre échange, celui que nous défendons ici, se méfie certes des interventions de l’État, car on ne voit pas pourquoi les fonctionnaires seraient omniscients, ou en tout cas plus savants que le marché. Mais il n’exclut pas non plus que dans certains cas précis, dont nous venons de citer des exemples, l’État ne doive intervenir pour permettre au libre échange de fonctionner correctement.
Dans de tels cas, les protections qui peuvent être instituées ne sont pas des folies arbitraires et contreproductives, comme le clament les profiteurs du libre-échangisme sans régulation. Elles rétablissent au contraire le véritable libre échange, celui qui permet aux consommateurs de choisir leurs achats en payant leurs vrais prix. Voilà pourquoi Jimmy Goldsmith était à son époque un véritable libéral, et un homme clairvoyant.
Le piège européen
Il y aura bientôt vingt ans que le discours de Jimmy Goldsmith a été prononcé, et depuis cette date, malgré les avertissements, la situation n’a fait qu’empirer. Que s’est-il passé ?
Tout simplement, l’ouverture des frontières nationales et européennes sans régulation, ou au prix d’une régulation minime, n’a fait que s’amplifier, déchirant toujours davantage notre tissu industriel.
Les pays de l’Union Européenne se sont trouvés pris dans un piège inattendu : ils avaient transféré à Bruxelles des pouvoirs de politique commerciale pour être plus forts et mieux protégés, mais ces pouvoirs ont été utilisés au contraire, avec un dogmatisme à la limite de l’absurde, pour ouvrir les frontières en les dotant seulement de régulations insignifiantes. La machine qui devait nous rendre plus forts nous a rendus plus faibles.
Le Traité de Rome avait supprimé les frontières intérieures de la Communauté tout en créant un « tarif extérieur commun » qui devait être appliqué, pensions-nous, dans un esprit de « préférence communautaire ». Pour le garantir, le Traité faisait des droits de douane une ressource propre des institutions européennes : plus elles protègeraient leurs membres, plus elles seraient alimentées financièrement.
Mais cet appât ne fut pas suffisant. Les mécanismes de décision étaient défaillants, et on ne l’avait pas vu : évacuation des Parlements nationaux, dépossédés de tout pouvoir sur les matières communautarisées ; négociations internationales menées par une Commission encadrée faiblement ; monopole d’initiative de la Commission, y compris pour les mandats de négociation ; affaiblissement du Conseil par le vote à la majorité qui divise les pays et permet à la Commission de s’infiltrer ; réduction du Parlement européen à un rôle symbolique de donneur d’avis en fin de processus, dans la quasi-totalité des cas pour soutenir la Commission ; enfin procédures et comités d’experts trop obscurs pour ne pas laisser prise aux groupes de pression et à toutes sortes d’intérêts particuliers. En un mot, des institutions européennes livrées à elles-mêmes avec d’immenses pouvoirs et peu de contrôle des États. Ce qui devait arriver arriva.
A partir du moment où les lobbies libre-échangistes avaient infiltré le système et faisaient régner leurs principes de dérégulation, tout le mécanisme européen allait jouer contre la protection des États. Le dogme de l’ouverture était si puissant, et ses avocats si efficaces, que la Commission a même accepté de saborder ses ressources financières en réduisant les droits de douane … quitte à venir ensuite pleurnicher auprès des États pour qu’ils lui affectent des financements de remplacement, en dépit de leur situation économique désastreuse, laquelle était largement provoquée, précisément, par le libre-échangisme dont la Commission était la première responsable. Bel exemple d’hypocrisie.
Nous avons expliqué ces effets pervers dans de nombreux textes sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir ici.(2)
Le discours de Jimmy Goldsmith prenait place après la signature des accords de Marrakech qui, concluant l’Uruguay Round, donnaient une nouvelle impulsion à la dérégulation du commerce aux frontières, et avant l’avis final du Parlement européen sur ces accords. Comme Philippe de Villiers et Jimmy Goldsmith ont été brillamment élus, et nous avec eux, nous avons ensuite eu l’honneur, dans un de nos premiers votes au Parlement, de nous opposer, sans succès hélas, à ce crime dont les pays européens continuent aujourd’hui à payer le prix. Ce fut notre première expérience douloureuse de la toute-puissance de la Commission, négociatrice de ces accords.
Depuis cette date, certes, les institutions européennes ont évolué. Par les récents traités, notamment celui de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil ont gagné quelques pouvoirs en matière de commerce extérieur.
Malheureusement ces réformes, dont certains attendaient un meilleur contrôle politique sur la Commission, ont abouti, par une déconcertante interversion des rôles, à une situation encore plus bloquée. C’est ce que l’on a constaté par exemple dans l’affaire des importations de panneaux photovoltaïques chinois : la Commission, se rendant compte de l’imminence d’un désastre dans une majorité de pays membres, voudrait imposer à ces produits des droits de douane punitifs, largement justifiés par les subventions reçues en Chine par leurs fabricants. Mais il existe une majorité au Conseil, emmenée par l’Allemagne, pour empêcher que cette protection dure plus de six mois, et que cette méthode soit appliquée plus largement. L’Allemagne et quelques autres font en effet le calcul qu’ils ont globalement beaucoup à perdre à une éventuelle détérioration de leurs relations avec la Chine, et ils préfèrent fermer les yeux sur les dégâts causés chez leurs voisins. Où est la solidarité européenne ?
Il y a quelque chose de quasiment diabolique dans cette évolution : que l’on s’y prenne comme on voudra, semble-t-il, l’aiguille de la politique européenne reste toujours bloquée dans le sens du libre-échangisme sans régulation, c’est-à-dire dans le sens de l’autodestruction. Finalement, aurions-nous fait plus mal si nous avions été seuls ?
Qu’est-ce que Bruxelles nous a apporté de plus dans ce domaine ? N’est-ce pas l’idée même d’un abandon de souveraineté sans contrepartie, dans le contexte de pays aux intérêts différents, qui était perverse ?
La mise en place de la monnaie unique est venue aggraver encore les effets du piège européen. Peut-être, dans un premier temps, certains avaient-ils imaginé que l’euro allait renforcer notre compétitivité dans le cadre libre-échangiste, en rationalisant les relations monétaires internes et en accentuant la concurrence par la transparence intra-européenne des prix. Lourde erreur. L’euro n’a pas ranimé la croissance, il a au contraire amplifié la crise.
La monnaie unique, créée dans une zone non propice, n’a fait qu’accentuer les divergences entre les États. Notamment, elle a laissé croire à certains pays, en leur procurant des taux d’intérêt bas, qu’ils pouvaient continuer à s’endetter. En plus, alignant tous les pays sur un change commun alors que leurs besoins sont différents, elle impose une rigidité qui est nuisible aux plus faibles, et finalement aussi aux plus forts, qui devraient dépenser leur énergie à aider les plus faibles à sortir des problèmes que leur inflige l’euro.
En même temps, le libre-échangisme ambiant ralentit la croissance partout, dans tous les pays, mais de manière inégale. Il exerce ainsi une « pression asymétrique » qui déséquilibre la monnaie unique et sera probablement la cause de sa fin. On se trouve au total devant une situation stupéfiante : deux politiques européennes qui se contredisent, aggravent mutuellement leurs inconvénients, et dont l’une finira probablement par détruire l’autre.(3)
Il y aura bientôt vingt ans que le discours de Jimmy Goldsmith a été prononcé, et depuis cette date, malgré les avertissements, la situation n’a fait qu’empirer. Que s’est-il passé ?
Tout simplement, l’ouverture des frontières nationales et européennes sans régulation, ou au prix d’une régulation minime, n’a fait que s’amplifier, déchirant toujours davantage notre tissu industriel.
Les pays de l’Union Européenne se sont trouvés pris dans un piège inattendu : ils avaient transféré à Bruxelles des pouvoirs de politique commerciale pour être plus forts et mieux protégés, mais ces pouvoirs ont été utilisés au contraire, avec un dogmatisme à la limite de l’absurde, pour ouvrir les frontières en les dotant seulement de régulations insignifiantes. La machine qui devait nous rendre plus forts nous a rendus plus faibles.
Le Traité de Rome avait supprimé les frontières intérieures de la Communauté tout en créant un « tarif extérieur commun » qui devait être appliqué, pensions-nous, dans un esprit de « préférence communautaire ». Pour le garantir, le Traité faisait des droits de douane une ressource propre des institutions européennes : plus elles protègeraient leurs membres, plus elles seraient alimentées financièrement.
Mais cet appât ne fut pas suffisant. Les mécanismes de décision étaient défaillants, et on ne l’avait pas vu : évacuation des Parlements nationaux, dépossédés de tout pouvoir sur les matières communautarisées ; négociations internationales menées par une Commission encadrée faiblement ; monopole d’initiative de la Commission, y compris pour les mandats de négociation ; affaiblissement du Conseil par le vote à la majorité qui divise les pays et permet à la Commission de s’infiltrer ; réduction du Parlement européen à un rôle symbolique de donneur d’avis en fin de processus, dans la quasi-totalité des cas pour soutenir la Commission ; enfin procédures et comités d’experts trop obscurs pour ne pas laisser prise aux groupes de pression et à toutes sortes d’intérêts particuliers. En un mot, des institutions européennes livrées à elles-mêmes avec d’immenses pouvoirs et peu de contrôle des États. Ce qui devait arriver arriva.
A partir du moment où les lobbies libre-échangistes avaient infiltré le système et faisaient régner leurs principes de dérégulation, tout le mécanisme européen allait jouer contre la protection des États. Le dogme de l’ouverture était si puissant, et ses avocats si efficaces, que la Commission a même accepté de saborder ses ressources financières en réduisant les droits de douane … quitte à venir ensuite pleurnicher auprès des États pour qu’ils lui affectent des financements de remplacement, en dépit de leur situation économique désastreuse, laquelle était largement provoquée, précisément, par le libre-échangisme dont la Commission était la première responsable. Bel exemple d’hypocrisie.
Nous avons expliqué ces effets pervers dans de nombreux textes sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir ici.(2)
Le discours de Jimmy Goldsmith prenait place après la signature des accords de Marrakech qui, concluant l’Uruguay Round, donnaient une nouvelle impulsion à la dérégulation du commerce aux frontières, et avant l’avis final du Parlement européen sur ces accords. Comme Philippe de Villiers et Jimmy Goldsmith ont été brillamment élus, et nous avec eux, nous avons ensuite eu l’honneur, dans un de nos premiers votes au Parlement, de nous opposer, sans succès hélas, à ce crime dont les pays européens continuent aujourd’hui à payer le prix. Ce fut notre première expérience douloureuse de la toute-puissance de la Commission, négociatrice de ces accords.
Depuis cette date, certes, les institutions européennes ont évolué. Par les récents traités, notamment celui de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil ont gagné quelques pouvoirs en matière de commerce extérieur.
Malheureusement ces réformes, dont certains attendaient un meilleur contrôle politique sur la Commission, ont abouti, par une déconcertante interversion des rôles, à une situation encore plus bloquée. C’est ce que l’on a constaté par exemple dans l’affaire des importations de panneaux photovoltaïques chinois : la Commission, se rendant compte de l’imminence d’un désastre dans une majorité de pays membres, voudrait imposer à ces produits des droits de douane punitifs, largement justifiés par les subventions reçues en Chine par leurs fabricants. Mais il existe une majorité au Conseil, emmenée par l’Allemagne, pour empêcher que cette protection dure plus de six mois, et que cette méthode soit appliquée plus largement. L’Allemagne et quelques autres font en effet le calcul qu’ils ont globalement beaucoup à perdre à une éventuelle détérioration de leurs relations avec la Chine, et ils préfèrent fermer les yeux sur les dégâts causés chez leurs voisins. Où est la solidarité européenne ?
Il y a quelque chose de quasiment diabolique dans cette évolution : que l’on s’y prenne comme on voudra, semble-t-il, l’aiguille de la politique européenne reste toujours bloquée dans le sens du libre-échangisme sans régulation, c’est-à-dire dans le sens de l’autodestruction. Finalement, aurions-nous fait plus mal si nous avions été seuls ?
Qu’est-ce que Bruxelles nous a apporté de plus dans ce domaine ? N’est-ce pas l’idée même d’un abandon de souveraineté sans contrepartie, dans le contexte de pays aux intérêts différents, qui était perverse ?
La mise en place de la monnaie unique est venue aggraver encore les effets du piège européen. Peut-être, dans un premier temps, certains avaient-ils imaginé que l’euro allait renforcer notre compétitivité dans le cadre libre-échangiste, en rationalisant les relations monétaires internes et en accentuant la concurrence par la transparence intra-européenne des prix. Lourde erreur. L’euro n’a pas ranimé la croissance, il a au contraire amplifié la crise.
La monnaie unique, créée dans une zone non propice, n’a fait qu’accentuer les divergences entre les États. Notamment, elle a laissé croire à certains pays, en leur procurant des taux d’intérêt bas, qu’ils pouvaient continuer à s’endetter. En plus, alignant tous les pays sur un change commun alors que leurs besoins sont différents, elle impose une rigidité qui est nuisible aux plus faibles, et finalement aussi aux plus forts, qui devraient dépenser leur énergie à aider les plus faibles à sortir des problèmes que leur inflige l’euro.
En même temps, le libre-échangisme ambiant ralentit la croissance partout, dans tous les pays, mais de manière inégale. Il exerce ainsi une « pression asymétrique » qui déséquilibre la monnaie unique et sera probablement la cause de sa fin. On se trouve au total devant une situation stupéfiante : deux politiques européennes qui se contredisent, aggravent mutuellement leurs inconvénients, et dont l’une finira probablement par détruire l’autre.(3)
"Monsieur le Président, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'on engendré !" Philippe de Villiers interpellant François Hollande (Parlement européen, 5 février 2013)
Comment s’en sortir ?
La dérégulation des frontières est la cause principale des crises entremêlées dans lesquelles nous sommes plongés. C’est la mère de toutes les crises qui s’enchaînent. Du point de vue de l’économie, le scénario est assez simple : la désindustrialisation sape la croissance, le chômage s’accroît, le pouvoir d’achat faiblit, les politiciens essaient de ranimer l’activité en ouvrant les vannes de la dépense publique, le déficit devient récurrent, le surendettement non maîtrisable … Et il faudrait parler aussi des effets de la dérégulation des frontières sur l’immigration incontrôlée (ce sera pour un autre jour).
Certains dirigeants, prenant conscience de l’impasse où nous sommes, essaient d’esquiver leurs responsabilités en faisant porter le chapeau à d’autres. Par exemple Pascal Lamy qui, dans une conférence à Sciences Po donnée le 31 août 2012, expliquait que la crise, devenue globale aujourd’hui, était née en réalité dans un secteur particulier, celui de l’industrie financière, dont les excès avaient déstabilisé le reste de l’économie : « je suis de ceux qui pensent que l’origine de la crise financière qui s’est transformée en crise économique et sociale globale se trouve dans le défaut de gouvernance, de régulation, de maîtrise d’une industrie plus globalisée encore que les autres ».(4)
Ainsi voudrait-on escamoter la responsabilité du libre-échangisme en criant haro sur les banquiers. Ce n’est pas moi, c’est l’autre. Mais pour être complet, il faudrait dire aussi que la dérégulation financière n’est pas arrivée par hasard. Elle a été acceptée pour la même raison que les déficits budgétaires : les gouvernants espéraient, puisque les économistes l’assuraient, qu’elle allait stimuler la croissance mise à mal par le libre-échangisme. Donc le déséquilibre initial, la mère principale de toutes les crises, c’est bien le libre-échangisme.
Par conséquent, du point de vue de l’économie, la reprise en mains des frontières est la clé principale et première d’un redressement. Mais comment réussir ? C’était encore facile il y a vingt ans, au moment où Jimmy Goldsmith prononçait son discours, mais c’est une gageure aujourd’hui.
Plusieurs voies sont imaginables, il est vrai plus insuffisantes ou escarpées les unes que les autres.
Première voie : celle que suivent l’Union européenne et les gouvernements en place, qui prêchent l’effort et la rigueur.
Cette démarche est cohérente avec les versions simplistes de la théorie du libre échange. Il faut avant tout améliorer notre compétitivité pour battre nos concurrents. L’argument n’est pas faux, mais il est aujourd’hui devenu insuffisant : il faut certes amplifier nos efforts d’innovation (mais ces mêmes innovations se diffusent très rapidement chez nos concurrents) ; il faut flexibiliser et dégonfler l’État-Providence (mais il n’est plus possible de revenir au niveau social de Chine) ; il faut réduire le déficit de l’État et les dépenses publiques (mais comment le faire efficacement lorsqu’on veut en même temps stimuler une croissance défaillante ?).
Face à la concurrence des pays émergents, ces remèdes ne sont plus, hélas, à la hauteur du problème. Il faut maintenant tenir compte de la dissymétrie qu’engendre d’un côté le subventionnement illimité, de l’autre la non-prise en compte des coûts cachés.
Deuxième voie : faire appel au « patriotisme économique » des citoyens.
Il faudrait demander aux consommateurs d’acheter des produits nationaux, même s’ils sont plus chers, afin de sauver notre pays de la désindustrialisation. Remède sympathique mais difficile à faire fonctionner. Il n’y aura jamais qu’une minorité de personnes qui accepteront de sacrifier leur pouvoir d’achat pour sauver des entreprises nationales. Et les autres, ceux qui n’auront pas voulu se montrer solidaires, rafleront tous les gains.
Nous sommes devant un phénomène classique de « passager clandestin ». Chacun, pris individuellement, a intérêt à profiter des produits importés à bas prix, tout en espérant que ses concitoyens, ou l’État, ou une collectivité quelconque (en tout cas pas lui) s’arrangeront pour maintenir les industries nationales en vie afin de préserver son emploi. L’ennui, c’est que lorsqu’il y a trop de passagers clandestins – et il finit toujours par y en avoir trop – la barque coule.
En fait, une situation aussi dommageable ne peut s’installer que si l’État ne joue pas son rôle. La solution serait d’avoir le courage de fixer des droits de douane aux frontières. Mais en l’absence de ce système, les appels des politiciens au « patriotisme économique » ne sont qu’une méthode pour fuir leurs propres responsabilités.
Troisième voie : trouver des moyens inédits pour relancer le moteur des économies européennes, afin de contrebalancer les effets néfastes de la désindustrialisation.
Au niveau national – et c’est encore plus vrai dans le cas français – les déficits publics, le niveau de la dette, le poids des prélèvements obligatoires, interdisent toute relance par la dépense publique, quoiqu’en disent quelques politiciens irréalistes. D’ailleurs, l’effet d’une injection supplémentaire d’argent public serait largement dilué dans l’économie mondiale, en raison de l’ouverture des frontières.
D’où l’idée d’opérer la relance au niveau européen. Un « plan Marshall européen ». Mais avec quel argent ? Celui des fonds structurels existants, comme certains le proposent ? C’est une plaisanterie. Ces crédits seront de toute façon dépensés dans l’économie européenne, et ils ne peuvent avoir d’influence qu’à la marge. Alors faut-il passer à la vitesse supérieure et les multiplier en empruntant ? Par exemple introduire des « obligations de projet » (« project bonds ») qui permettraient d’emprunter sur le marché international des montants très importants, à réinjecter aussitôt dans l’économie européenne ?
Il ne faut pas suivre ce mauvais conseil. Ce serait le plus sûr moyen d’achever notre ruine. A notre endettement déjà excessif, nous ajouterions des emprunts européens dépensés aussitôt en pure perte, ou pour un profit minime, toujours en raison de l’ouverture des frontières. Nous n’aurions plus qu’à vendre aux Chinois ou aux Qataris le reste de notre patrimoine national pour payer les remboursements (ce que d’ailleurs nos gouvernants commencent à faire sans l’exprimer ainsi).
Autre opération européenne envisagée : lâcher la bride à la création monétaire, comme aux Etats-Unis ou au Japon. C’est d’ailleurs déjà commencé, sans résultat très sensible du côté de la croissance. Mais en faussant les relations monétaires, on fausse toutes les relations économiques. D’où, entre autres, le risque de « bulles » de la Bourse, de l’immobilier, du crédit… Bulles qui explosent un jour en provoquant des dégâts considérables, et déstabilisent la croissance au lieu de la favoriser.
Arrive enfin la dernière idée de relance : bien sûr, l’Allemagne paiera ! Elle paiera en contribuant davantage aux opérations européennes, en garantissant les emprunts de Bruxelles, et si ce n’est pas possible, en augmentant ses salaires nationaux pour relancer les achats des Allemands, qui eux-mêmes relanceront toute l’Europe… Il est improbable que les Allemands acceptent d’entrer dans ce jeu. Car s’ils y entraient, ils se ruineraient sans sauver les autres.
Quatrième voie : instituer au niveau mondial quelques règles commerciales simples qui prendraient en compte le fait nouveau de la concurrence massive des pays émergents, et qui organiseraient des échanges favorisant le développement des pays pauvres sans détruire les pays déjà développés.
En un mot exclure le développement par prédation aux dépens des plus avancés ; organiser le développement partagé, celui qui d’ailleurs correspond exactement à l’objectif classique du libre échange.
Cette proposition est la plus sensée de toutes celles examinées jusqu’ici, et c’est sans doute par là que les Européens auraient dû commencer. Il y a vingt ans tout juste, Philippe de Villiers présentait déjà des propositions en ce sens dans son livre « Avant qu’il ne soit trop tard », que tout le monde ferait bien de relire aujourd’hui.(5)
Il appelait alors à un « nouvel ordre mondial de l’emploi » et préconisait l’adoption d’un code international de bonne conduite. Ce code aurait dû permettre un développement des pays émergents plus « autocentré », c’est-à-dire profitant davantage aux ouvriers des pays pauvres sans détruire l’emploi des ouvriers des pays riches. Le moyen serait la légitimation de droits compensateurs aux frontières dont le produit pourrait être retourné, en tout ou partie, aux organismes locaux ou multilatéraux de développement.
Aujourd’hui, devant le désastre subi par les économies européennes, quelques voix s’élèvent pour demander « davantage de régulations globales, en particulier en matière sociale et environnementale ». Ces régulations, selon nous, pourraient s’articuler sur des droits compensateurs, dans les cas où des produits importés ont été fabriqués au prix de pratiques sociales inacceptables, de salaires dérisoires, ou de dommages infligés à l’environnement.
Hélas, il faut quand même dire, pour être réaliste, que la meilleure occasion d’instituer ce code de bonne conduite a été manquée en 1994, au moment où des politiciens inconscients ont poussé les pays d’Europe à ratifier les accords de Marrakech, lesquels procédaient à une ouverture commerciale quasi-générale et dépourvue de garde-fous. Parmi les serviteurs zélés de ces accords figure Pascal Lamy, actuel directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce, chien de garde de la mondialisation dérégulée, qui est aussi l’auteur, dernièrement, … de la citation ci-dessus (6). Il est bien tard pour se rendre compte de l’erreur.
Cinquième voie : établir des « droits compensateurs » aux frontières extérieures de l’Union Européenne.
Le code mondial de bonne conduite commerciale risque de se faire attendre longtemps. Sans doute aurait-il pu être institué il y a vingt ans, lorsque nous avions encore des moyens de pression et que nous pouvions faire miroiter aux tiers l’attrait de baisses de nos tarifs douaniers. Mais aujourd’hui, c’est devenu bien plus difficile car nous avons presque tout donné sans demander de concessions en échange, et que les pays émergents, qui croient n’avoir aucun intérêt à ce genre de règles, sont devenus trop forts.
Alors sans doute serons-nous contraints d’instaurer par nous-mêmes des droits compensateurs. Cette solution n’est pas parfaite. Nous connaissons par cœur tous ses défauts, tant les libre-échangistes nous les ont répétés pour nous terroriser.
D’abord, il aurait mieux valu que l’instauration de droits compensateurs résulte d’une action concertée au niveau mondial. Mais si nos partenaires asiatiques ne veulent pas discuter, nous n’aurons plus le choix.
Ensuite il sera difficile d’obtenir que tous les membres de l’Union jouent le jeu, et il faudra sans doute se contenter de réunir seulement certains États dans une « coopération renforcée ».
Enfin, troisième inconvénient, l’opération entraînera pour nous des contrecoups douloureux, susceptibles d’affecter la présence de nos entreprises dans les pays visés, les importations de certains produits dont nous avons besoin, ou encore l’activité des entreprises qui, chez nous, transforment ces produits. Le solde final sera peut-être moins positif qu’on aurait pu le croire. Mais c’est mieux que de se laisser mourir. Il faut choisir.
Au moins, comme nous l’avons vu, ne s’agit-il pas du tout d’une idée antilibérale. Au contraire, les droits compensateurs offrent un moyen pour rétablir la vérité des prix sur le marché en incluant dans le prix d’un produit importé le coût des dommages qu’il peut causer.
La Commission européenne semble actuellement se réveiller un peu en manifestant le désir de taxer certaines importations chinoises qui bénéficient manifestement d’aides publiques. Cette idée est bien tardive, bien trop ponctuelle, et elle est déjà soumise aux critiques de certains de nos partenaires, alarmés par le risque de mesures de rétorsion. Il leur sera facile de mettre en branle l’effrayante « machine à ne rien faire » qui se cache dans les procédures de Bruxelles. Pourtant, l’opération mérite d’être tentée.
Evidemment, les pays émergents, et d’abord la Chine, useront de toutes leurs armes pour préserver le statu quo libre-échangiste, y compris en faisant appel à l’OMC chère à M. Lamy. Nous devrons alors leur expliquer que la mondialisation ne peut pas fonctionner au profit d’un seul, et que si le système économique et social des pays européens s’écroule, personne n’y gagnera. D’ailleurs, eux-mêmes ont-ils intérêt à tout miser sur un développement prédateur ?
… et si rien de tout cela n’est possible …
Regardons la situation en face. Les orientations de solutions que nous venons d’examiner paraissent toutes, finalement, très difficiles à mettre en œuvre au point où nous en sommes arrivés. Il faudrait disposer à la tête du pays d’hommes d’État clairvoyants, désintéressés, dévoués au peuple, libérés de tous liens avec la finance internationale ou avec Bruxelles (qui en est trop souvent le porte-parole), d’hommes d’État courageux, d’un caractère trempé, prêts à assumer les épreuves de force, mais en même temps suffisamment subtils pour savoir utiliser les failles du système de prédation dont nous sommes victimes. Qui peut dire que nous avons ces hommes à notre disposition ? (7)
En admettant que nous les ayons, quelle carte faudrait-il jouer ? La quatrième voie étudiée plus haut (le code mondial de bonne conduite) et/ou la cinquième voie (les droits compensateurs au niveau européen), paraissent certes difficiles, mais plus productives que les autres. En effet, si ce type de solution était mis en place, il fournirait un cadre protecteur pour les autres axes d’effort, il leur fournirait un adjuvant et valoriserait leurs effets. Mais il ne faut pas perdre de vue que le premier adversaire surgirait au sein même de notre camp, exploitant le fatras de procédures bruxelloises et de verrous libre-échangistes que nos politiciens ont mis en place depuis vingt ans, dans le dos des peuples, ou bien en leur mentant sur la portée véritable des nouveaux traités.
Si nous avions négocié ces régulations avant d’abolir nos droits de douane, cela aurait été assez facile. Mais vouloir les établir après exigera un travail de titan pour nos gouvernants et nos diplomates.
Il faudra d’abord gagner la bataille des idées : montrer que les droits compensateurs ne sont pas contraires au vrai libre échange. Puis éjecter les politiciens qui ont partie liée avec le système dévastateur imposé à l’Europe. Enfin détricoter les procédures européennes qui privent les peuples de leur souveraineté.
Si nous ne réussissons pas à lever ces blocages, alors disons-le sans détour : nous serons engagés dans un déclin économique de dix ans au bas mot, avec des récessions entrecoupées de petites reprises avortées, une ruine progressive du pouvoir d’achat et du patrimoine national, la dislocation de nos sociétés, un effacement des pays européens de la scène mondiale, et ce constat effrayant que les institutions européennes auront détruit l’Europe.
Ce déclin ne prendra fin, peut-être, que le jour où le niveau de vie des Chinois et le nôtre s’équilibreront au même niveau. Mais dans quel état serons-nous alors ?
La dérégulation des frontières est la cause principale des crises entremêlées dans lesquelles nous sommes plongés. C’est la mère de toutes les crises qui s’enchaînent. Du point de vue de l’économie, le scénario est assez simple : la désindustrialisation sape la croissance, le chômage s’accroît, le pouvoir d’achat faiblit, les politiciens essaient de ranimer l’activité en ouvrant les vannes de la dépense publique, le déficit devient récurrent, le surendettement non maîtrisable … Et il faudrait parler aussi des effets de la dérégulation des frontières sur l’immigration incontrôlée (ce sera pour un autre jour).
Certains dirigeants, prenant conscience de l’impasse où nous sommes, essaient d’esquiver leurs responsabilités en faisant porter le chapeau à d’autres. Par exemple Pascal Lamy qui, dans une conférence à Sciences Po donnée le 31 août 2012, expliquait que la crise, devenue globale aujourd’hui, était née en réalité dans un secteur particulier, celui de l’industrie financière, dont les excès avaient déstabilisé le reste de l’économie : « je suis de ceux qui pensent que l’origine de la crise financière qui s’est transformée en crise économique et sociale globale se trouve dans le défaut de gouvernance, de régulation, de maîtrise d’une industrie plus globalisée encore que les autres ».(4)
Ainsi voudrait-on escamoter la responsabilité du libre-échangisme en criant haro sur les banquiers. Ce n’est pas moi, c’est l’autre. Mais pour être complet, il faudrait dire aussi que la dérégulation financière n’est pas arrivée par hasard. Elle a été acceptée pour la même raison que les déficits budgétaires : les gouvernants espéraient, puisque les économistes l’assuraient, qu’elle allait stimuler la croissance mise à mal par le libre-échangisme. Donc le déséquilibre initial, la mère principale de toutes les crises, c’est bien le libre-échangisme.
Par conséquent, du point de vue de l’économie, la reprise en mains des frontières est la clé principale et première d’un redressement. Mais comment réussir ? C’était encore facile il y a vingt ans, au moment où Jimmy Goldsmith prononçait son discours, mais c’est une gageure aujourd’hui.
Plusieurs voies sont imaginables, il est vrai plus insuffisantes ou escarpées les unes que les autres.
Première voie : celle que suivent l’Union européenne et les gouvernements en place, qui prêchent l’effort et la rigueur.
Cette démarche est cohérente avec les versions simplistes de la théorie du libre échange. Il faut avant tout améliorer notre compétitivité pour battre nos concurrents. L’argument n’est pas faux, mais il est aujourd’hui devenu insuffisant : il faut certes amplifier nos efforts d’innovation (mais ces mêmes innovations se diffusent très rapidement chez nos concurrents) ; il faut flexibiliser et dégonfler l’État-Providence (mais il n’est plus possible de revenir au niveau social de Chine) ; il faut réduire le déficit de l’État et les dépenses publiques (mais comment le faire efficacement lorsqu’on veut en même temps stimuler une croissance défaillante ?).
Face à la concurrence des pays émergents, ces remèdes ne sont plus, hélas, à la hauteur du problème. Il faut maintenant tenir compte de la dissymétrie qu’engendre d’un côté le subventionnement illimité, de l’autre la non-prise en compte des coûts cachés.
Deuxième voie : faire appel au « patriotisme économique » des citoyens.
Il faudrait demander aux consommateurs d’acheter des produits nationaux, même s’ils sont plus chers, afin de sauver notre pays de la désindustrialisation. Remède sympathique mais difficile à faire fonctionner. Il n’y aura jamais qu’une minorité de personnes qui accepteront de sacrifier leur pouvoir d’achat pour sauver des entreprises nationales. Et les autres, ceux qui n’auront pas voulu se montrer solidaires, rafleront tous les gains.
Nous sommes devant un phénomène classique de « passager clandestin ». Chacun, pris individuellement, a intérêt à profiter des produits importés à bas prix, tout en espérant que ses concitoyens, ou l’État, ou une collectivité quelconque (en tout cas pas lui) s’arrangeront pour maintenir les industries nationales en vie afin de préserver son emploi. L’ennui, c’est que lorsqu’il y a trop de passagers clandestins – et il finit toujours par y en avoir trop – la barque coule.
En fait, une situation aussi dommageable ne peut s’installer que si l’État ne joue pas son rôle. La solution serait d’avoir le courage de fixer des droits de douane aux frontières. Mais en l’absence de ce système, les appels des politiciens au « patriotisme économique » ne sont qu’une méthode pour fuir leurs propres responsabilités.
Troisième voie : trouver des moyens inédits pour relancer le moteur des économies européennes, afin de contrebalancer les effets néfastes de la désindustrialisation.
Au niveau national – et c’est encore plus vrai dans le cas français – les déficits publics, le niveau de la dette, le poids des prélèvements obligatoires, interdisent toute relance par la dépense publique, quoiqu’en disent quelques politiciens irréalistes. D’ailleurs, l’effet d’une injection supplémentaire d’argent public serait largement dilué dans l’économie mondiale, en raison de l’ouverture des frontières.
D’où l’idée d’opérer la relance au niveau européen. Un « plan Marshall européen ». Mais avec quel argent ? Celui des fonds structurels existants, comme certains le proposent ? C’est une plaisanterie. Ces crédits seront de toute façon dépensés dans l’économie européenne, et ils ne peuvent avoir d’influence qu’à la marge. Alors faut-il passer à la vitesse supérieure et les multiplier en empruntant ? Par exemple introduire des « obligations de projet » (« project bonds ») qui permettraient d’emprunter sur le marché international des montants très importants, à réinjecter aussitôt dans l’économie européenne ?
Il ne faut pas suivre ce mauvais conseil. Ce serait le plus sûr moyen d’achever notre ruine. A notre endettement déjà excessif, nous ajouterions des emprunts européens dépensés aussitôt en pure perte, ou pour un profit minime, toujours en raison de l’ouverture des frontières. Nous n’aurions plus qu’à vendre aux Chinois ou aux Qataris le reste de notre patrimoine national pour payer les remboursements (ce que d’ailleurs nos gouvernants commencent à faire sans l’exprimer ainsi).
Autre opération européenne envisagée : lâcher la bride à la création monétaire, comme aux Etats-Unis ou au Japon. C’est d’ailleurs déjà commencé, sans résultat très sensible du côté de la croissance. Mais en faussant les relations monétaires, on fausse toutes les relations économiques. D’où, entre autres, le risque de « bulles » de la Bourse, de l’immobilier, du crédit… Bulles qui explosent un jour en provoquant des dégâts considérables, et déstabilisent la croissance au lieu de la favoriser.
Arrive enfin la dernière idée de relance : bien sûr, l’Allemagne paiera ! Elle paiera en contribuant davantage aux opérations européennes, en garantissant les emprunts de Bruxelles, et si ce n’est pas possible, en augmentant ses salaires nationaux pour relancer les achats des Allemands, qui eux-mêmes relanceront toute l’Europe… Il est improbable que les Allemands acceptent d’entrer dans ce jeu. Car s’ils y entraient, ils se ruineraient sans sauver les autres.
Quatrième voie : instituer au niveau mondial quelques règles commerciales simples qui prendraient en compte le fait nouveau de la concurrence massive des pays émergents, et qui organiseraient des échanges favorisant le développement des pays pauvres sans détruire les pays déjà développés.
En un mot exclure le développement par prédation aux dépens des plus avancés ; organiser le développement partagé, celui qui d’ailleurs correspond exactement à l’objectif classique du libre échange.
Cette proposition est la plus sensée de toutes celles examinées jusqu’ici, et c’est sans doute par là que les Européens auraient dû commencer. Il y a vingt ans tout juste, Philippe de Villiers présentait déjà des propositions en ce sens dans son livre « Avant qu’il ne soit trop tard », que tout le monde ferait bien de relire aujourd’hui.(5)
Il appelait alors à un « nouvel ordre mondial de l’emploi » et préconisait l’adoption d’un code international de bonne conduite. Ce code aurait dû permettre un développement des pays émergents plus « autocentré », c’est-à-dire profitant davantage aux ouvriers des pays pauvres sans détruire l’emploi des ouvriers des pays riches. Le moyen serait la légitimation de droits compensateurs aux frontières dont le produit pourrait être retourné, en tout ou partie, aux organismes locaux ou multilatéraux de développement.
Aujourd’hui, devant le désastre subi par les économies européennes, quelques voix s’élèvent pour demander « davantage de régulations globales, en particulier en matière sociale et environnementale ». Ces régulations, selon nous, pourraient s’articuler sur des droits compensateurs, dans les cas où des produits importés ont été fabriqués au prix de pratiques sociales inacceptables, de salaires dérisoires, ou de dommages infligés à l’environnement.
Hélas, il faut quand même dire, pour être réaliste, que la meilleure occasion d’instituer ce code de bonne conduite a été manquée en 1994, au moment où des politiciens inconscients ont poussé les pays d’Europe à ratifier les accords de Marrakech, lesquels procédaient à une ouverture commerciale quasi-générale et dépourvue de garde-fous. Parmi les serviteurs zélés de ces accords figure Pascal Lamy, actuel directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce, chien de garde de la mondialisation dérégulée, qui est aussi l’auteur, dernièrement, … de la citation ci-dessus (6). Il est bien tard pour se rendre compte de l’erreur.
Cinquième voie : établir des « droits compensateurs » aux frontières extérieures de l’Union Européenne.
Le code mondial de bonne conduite commerciale risque de se faire attendre longtemps. Sans doute aurait-il pu être institué il y a vingt ans, lorsque nous avions encore des moyens de pression et que nous pouvions faire miroiter aux tiers l’attrait de baisses de nos tarifs douaniers. Mais aujourd’hui, c’est devenu bien plus difficile car nous avons presque tout donné sans demander de concessions en échange, et que les pays émergents, qui croient n’avoir aucun intérêt à ce genre de règles, sont devenus trop forts.
Alors sans doute serons-nous contraints d’instaurer par nous-mêmes des droits compensateurs. Cette solution n’est pas parfaite. Nous connaissons par cœur tous ses défauts, tant les libre-échangistes nous les ont répétés pour nous terroriser.
D’abord, il aurait mieux valu que l’instauration de droits compensateurs résulte d’une action concertée au niveau mondial. Mais si nos partenaires asiatiques ne veulent pas discuter, nous n’aurons plus le choix.
Ensuite il sera difficile d’obtenir que tous les membres de l’Union jouent le jeu, et il faudra sans doute se contenter de réunir seulement certains États dans une « coopération renforcée ».
Enfin, troisième inconvénient, l’opération entraînera pour nous des contrecoups douloureux, susceptibles d’affecter la présence de nos entreprises dans les pays visés, les importations de certains produits dont nous avons besoin, ou encore l’activité des entreprises qui, chez nous, transforment ces produits. Le solde final sera peut-être moins positif qu’on aurait pu le croire. Mais c’est mieux que de se laisser mourir. Il faut choisir.
Au moins, comme nous l’avons vu, ne s’agit-il pas du tout d’une idée antilibérale. Au contraire, les droits compensateurs offrent un moyen pour rétablir la vérité des prix sur le marché en incluant dans le prix d’un produit importé le coût des dommages qu’il peut causer.
La Commission européenne semble actuellement se réveiller un peu en manifestant le désir de taxer certaines importations chinoises qui bénéficient manifestement d’aides publiques. Cette idée est bien tardive, bien trop ponctuelle, et elle est déjà soumise aux critiques de certains de nos partenaires, alarmés par le risque de mesures de rétorsion. Il leur sera facile de mettre en branle l’effrayante « machine à ne rien faire » qui se cache dans les procédures de Bruxelles. Pourtant, l’opération mérite d’être tentée.
Evidemment, les pays émergents, et d’abord la Chine, useront de toutes leurs armes pour préserver le statu quo libre-échangiste, y compris en faisant appel à l’OMC chère à M. Lamy. Nous devrons alors leur expliquer que la mondialisation ne peut pas fonctionner au profit d’un seul, et que si le système économique et social des pays européens s’écroule, personne n’y gagnera. D’ailleurs, eux-mêmes ont-ils intérêt à tout miser sur un développement prédateur ?
… et si rien de tout cela n’est possible …
Regardons la situation en face. Les orientations de solutions que nous venons d’examiner paraissent toutes, finalement, très difficiles à mettre en œuvre au point où nous en sommes arrivés. Il faudrait disposer à la tête du pays d’hommes d’État clairvoyants, désintéressés, dévoués au peuple, libérés de tous liens avec la finance internationale ou avec Bruxelles (qui en est trop souvent le porte-parole), d’hommes d’État courageux, d’un caractère trempé, prêts à assumer les épreuves de force, mais en même temps suffisamment subtils pour savoir utiliser les failles du système de prédation dont nous sommes victimes. Qui peut dire que nous avons ces hommes à notre disposition ? (7)
En admettant que nous les ayons, quelle carte faudrait-il jouer ? La quatrième voie étudiée plus haut (le code mondial de bonne conduite) et/ou la cinquième voie (les droits compensateurs au niveau européen), paraissent certes difficiles, mais plus productives que les autres. En effet, si ce type de solution était mis en place, il fournirait un cadre protecteur pour les autres axes d’effort, il leur fournirait un adjuvant et valoriserait leurs effets. Mais il ne faut pas perdre de vue que le premier adversaire surgirait au sein même de notre camp, exploitant le fatras de procédures bruxelloises et de verrous libre-échangistes que nos politiciens ont mis en place depuis vingt ans, dans le dos des peuples, ou bien en leur mentant sur la portée véritable des nouveaux traités.
Si nous avions négocié ces régulations avant d’abolir nos droits de douane, cela aurait été assez facile. Mais vouloir les établir après exigera un travail de titan pour nos gouvernants et nos diplomates.
Il faudra d’abord gagner la bataille des idées : montrer que les droits compensateurs ne sont pas contraires au vrai libre échange. Puis éjecter les politiciens qui ont partie liée avec le système dévastateur imposé à l’Europe. Enfin détricoter les procédures européennes qui privent les peuples de leur souveraineté.
Si nous ne réussissons pas à lever ces blocages, alors disons-le sans détour : nous serons engagés dans un déclin économique de dix ans au bas mot, avec des récessions entrecoupées de petites reprises avortées, une ruine progressive du pouvoir d’achat et du patrimoine national, la dislocation de nos sociétés, un effacement des pays européens de la scène mondiale, et ce constat effrayant que les institutions européennes auront détruit l’Europe.
Ce déclin ne prendra fin, peut-être, que le jour où le niveau de vie des Chinois et le nôtre s’équilibreront au même niveau. Mais dans quel état serons-nous alors ?
G.B
[1] Pierre Manent, La crise du libéralisme, Revue Commentaire, N° 141, printemps 2013, page 91.
[2] Par exemple Georges Berthu L’Europe sans les peuples – L’essentiel sur le projet de Constitution européenne, Editions François-Xavier de Guibert, décembre 2004. Voir notamment l’annexe 9 La Constitution et le libre-échangisme.
[3] Voir nos contributions sur le site de l’Observatoire de l’Europe http://www.observatoiredeleurope.com notamment les 6 septembre 2011 et 29 mars 2013.
[4] Revue Commentaire, N° 141, page 7.
[5] Philippe de Villiers Avant qu’il ne soit trop tard - Albin Michel, 1993. Voir notamment Pour un nouvel ordre mondial de l’emploi, pages 21 et suivantes.
[6] JDD, 5 mai 2013.
[7] En tout cas on ne les trouvera pas dans la liste des députés nationaux, députés européens ou sénateurs qui se sont pressés en masse pour dire « oui » aux accords de Marrakech.

 A la Une
A la Une









 Jimmy Goldsmith, le libre-échange et la protection légitime
Jimmy Goldsmith, le libre-échange et la protection légitime