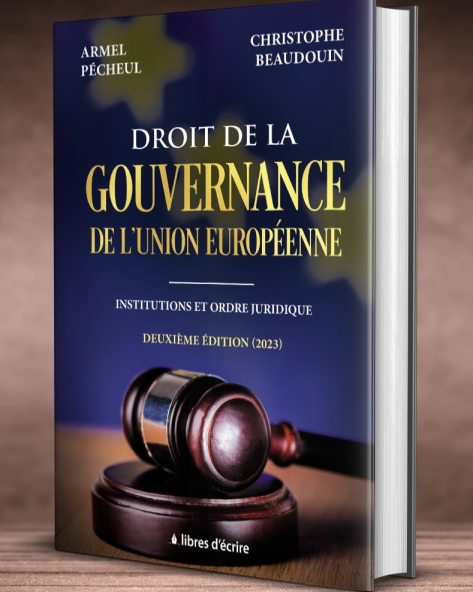Propos recueillis par François-Laurent Balssa, pour "Le Spectacle du Monde"
Vous êtes philosophe et historien des idées politiques. Qu’est-ce qui a suscité chez vous cet intérêt pour la politique ?
C’est le sentiment que les grands enjeux de la vie humaine se donnent à voir et se jouent d’abord dans la vie politique. Il faut se garder de deux tentations, entre lesquelles l’Occident oscille dangereusement : celle qui consiste à dire de la politique qu’elle n’a pas d’intérêt, la vraie vie étant ailleurs ; et celle qui conduit à une politisation exacerbée, partiale et agressive, comme ce fut le cas lors des épisodes totalitaires. Je m’efforce de tenir la ligne de crête entre ces deux excès, dévaluation et surévaluation du politique, ou, pour le dire d’un mot, de réévaluer la chose politique en la pensant à travers deux grandes notions : la notion de régime politique élaborée par les Grecs, et la notion de forme politique : cité, empire ou nation.
Mais pourriez-vous définir en quelques mots ce qu’est la politique ?
La meilleure façon de définir la chose politique, c’est de partir de sa naissance. Comment vivent les hommes quand ils ne s’inscrivent pas dans la forme politique ? Ils vivent dans un ordre familial. C’est l’ordre des pères. L’organisation collective repose alors sur une certaine modalité de l’ordre familial, tribal, clanique. Cet ordre s’observe dans toutes les aires de civilisation. C’est donc lorsque les hommes sortent de ce modèle familial que l’ordre politique émerge. Comment ? En introduisant un élément radicalement inédit : la chose commune. Avec elle, surgit un élément nouveau qui n’appartient à personne, sinon à la communauté, laquelle doit s’organiser politiquement pour le mettre en œuvre. En somme, cette transformation de la condition première de la vie humaine – ce qu’est la politique – est dans l’ordre des choses, l’homme étant un animal politique, mais elle aurait très bien pu ne pas voir le jour sans l’œuvre des Grecs. Les Grecs basculent la vie humaine pour ainsi dire en avant. C’est le point de départ de l’aventure occidentale. Les règles de vie ne sont plus données, ni par les dieux, ni par la tradition, ni par la figure du père. Elle est placée devant nous, avec l’incertitude de l’avenir. Se pose alors la question du « que faire ? » Les Grecs découvrent l’urgence de la « chose à faire », parce que le sort humain dépend désormais de nos actions.
On vous rétorquera qu’il y a eu des cités avant la cité grecque.
La cité, avec toutes ses dimensions, apparaît en Grèce. Il y a dans ce moment fondateur quelque chose de radicalement nouveau et de prodigieusement productif. Il est le propre de la cité grecque et ne cessera d’être décliné dans ce qu’il faut appeler l’Occident. Il y a eu des rassemblements humains dans quantité de civilisations, mais on ne trouve qu’en Grèce la production d’une chose commune gouvernée par la délibération des membres de la communauté, une bonne délibération conduisant à une action bonne.
Cette nouveauté est lourde d’incertitudes parce que, pour la première fois, les hommes sont confrontés à l’informel. La cité s’interroge sur ce qu’elle est. En quoi consiste-t-elle ? Qu’est-ce qui la définit? Quels en sont les membres et comment en devient-on membre ? Ces questions donnent naissance à la philosophie politique. Elles ne vont pas cesser de mobiliser l’Occident. S’il y a eu des sages dans toutes les civilisations, la philosophie politique ne se déploie qu’en Grèce. C’est une modalité d’interrogation très particulière sur le sens des mots qui orientent la vie de la cité : justice, vertu, courage…
Les Grecs vont également classifier les différents types de gouvernement…
Les Grecs découvrent que la vie politique est nécessairement spécifiée par le régime : elle est démocratique, oligarchique, monarchique. Il n’y a pas un nombre indéfini de régimes politiques. Un régime, c’est toujours un certain jeu entre le grand nombre, le petit nombre et l’individu isolé. Les Grecs, spécialement Platon et Aristote, montrent une intelligence inégalée pour décrire ces différents régimes. La vie humaine se concrétise de façon distincte selon que l’on vit en régime démocratique, oligarchique ou tyrannique. D’un régime à l’autre, les passions et les dispositions qui s’y montrent ne sont pas les mêmes. De là vient que la science politique est aussi science psychologique, pour ainsi dire science de l’humanité, science à laquelle il nous faut toujours revenir, non pour répéter les Grecs, mais pour comprendre la situation politique dans laquelle nous vivons.
Notre classification, à nous, Modernes, s’est rétrécie. C’est l’opposition entre régimes démocratiques et non démocratiques…
A partir des révolutions américaine et française, on assiste à une très grande simplification. Les Grecs distinguaient la bonne royauté de la mauvaise tyrannie, la bonne aristocratie de la mauvaise oligarchie, la démocratie excessive de la démocratie réglée. Mais, depuis le XIXe siècle, il n’y a plus qu’un seul régime légitime : le régime démocratique. C’est une simplification commode, mais elle ne facilite pas la compréhension des choses, tant il est clair que nul régime ne peut être uniquement démocratique, même s’il tire sa légitimité de la volonté du peuple. C’est toujours un mélange à proportions variables du grand nombre, du petit nombre et de l’unité.
C’est ce qui vous fait dire : « Si la démocratie est irrésistible, l’oligarchie est indestructible »?
Le mouvement naturel de la politique est celui de la démocratisation. La première cité est restreinte, mais elle est appelée à s’étendre. Étant donné le progrès d’humanité qu’elle représente, ceux qui en sont exclus demandent à en faire partie. C’est le mouvement structurel de la vie politique. Mais ce mouvement de démocratisation comporte son propre effet d’entraînement. Comme tout mouvement, il peut aller trop loin. Le bon régime devra donc tenir compte de la nécessité démocratique – soit le plus grand nombre possible de citoyens devant participer à la chose commune –, mais à la condition que cette nécessité ne mette pas en péril les autres composantes essentielles de la cité, parmi lesquelles des « petits nombres » eux aussi nécessaires. Ce que nous appelons la méritocratie, autrement dit l’idée que les fonctions doivent être accordées selon les mérites, ne suggère-t-elle pas qu’il y a une composante oligarchique légitime dans les sociétés démocratiques ?
A la différence des mondes grec et romain, l’Europe moderne a inventé une forme nouvelle, la nation. Comment a-t-elle émergé ?
Commençons par le commencement. Après la fin de l’Empire romain, long processus de dissolution, les Européens ne savent plus trop comment s’orienter dans le monde. Ils disposent alors de trois grandes références : l’expérience de la cité, celle de l’empire et celle de l’Eglise. Car cette dernière, communauté qui embrasse tous les êtres humains, est elle aussi une forme politique. Dans un contexte de désorientation collective, elle gagne rapidement en autorité. Les Européens vont longuement hésiter sur le choix de leur cadre de vie. Sera-ce la cité, ainsi des cités italiennes, flamandes, hanséatiques ? L’empire, tel le Saint Empire romain germanique ? Ou l’Eglise ? Aucune de ces possibilités ne va finalement s’imposer. Ce qui va advenir progressivement, c’est la nation proprement européenne. A l’installation de ce processus, il y a une condition préalable : c’est la consolidation du phénomène dynastique. Mais c’est seulement lors de la Réforme que la nation, au sens moderne du terme, apparaît, quand l’Eglise chrétienne est pour ainsi dire nationalisée. La Réforme, c’est le moment où chaque circonscription de la chrétienté décide de s’approprier le christianisme pour son usage propre. Car le geste de Luther est aussi un geste politique. Chaque nation européenne aura ainsi sa version de la Réforme, ou de la Contre-Réforme. Chacune va se constituer autour d’un choix confessionnel.
On fait toujours commencer l’histoire de l’Europe moderne à partir du développement de l’Etat, le rôle du monarque absolu ouvrant la voie à celui de l’Etat souverain. Il ne s’agit pas de nier ce rôle, il est capital, mais il fait suite à la cristallisation de la nation confessionnelle. Prenez les deux grandes nations qui accouchent de la modernité politique en Europe : la France et l’Angleterre. Dans ces deux pays, le choix primordial est le choix confessionnel que la nation a fait contre la dynastie légitime. L’Angleterre a voulu rester protestante contre les Stuarts lors de la Glorieuse Révolution de 1688. Un siècle plus tôt, la France avait obligé l’héritier légitime de la couronne, un protestant, à devenir catholique. La nation européenne se trouve donc à la jonction de la nation à marque confessionnelle et de l’Etat souverain et libéral, qui aura de plus en plus vocation à être neutre confessionnellement. C’est donc ce mélange compliqué, subtil, parfois conflictuel, qui fait le propre de la nation européenne.
Et qui est aujourd’hui en crise…
La situation aujourd’hui est extrêmement floue parce que les composantes de la synthèse nationale sont incertaines. La marque confessionnelle de la nation s’est affaiblie pendant que la souveraineté de l’Etat s’est érodée. C’est donc l’appartenance même à ce corps politique appelé nation qui devient problématique. Il faut mesurer la gravité de la remise en question. Ce sont les composantes primordiales de la vie commune qui se trouvent en crise. C’est très sensible en France, pays extrêmement politisé jusqu’à une époque récente, et où l’on considère aujourd’hui que les grands enjeux politiques sont liés à une forme archaïque d’existence dont nous serions heureusement sortis. Les grands référents politiques de la classe sociale et de la nation, qui, pendant les deux derniers siècles, ont organisé la vie des Européens, pour le meilleur et pour le pire, sont éprouvés comme désuets. Les Européens s’abandonnent au mouvement des choses, qu’ils appellent « mondialisation ». Or, il n’y a pas d’illusion plus dangereuse que celle qui consiste à croire que la politique appartient au passé et que le mouvement de la civilisation démocratique se suffit à lui-même.
On a l’impression que, sur l’Europe, règne comme une sorte de dépression post-totalitaire.
Le désir européen de sortir de l’histoire est enraciné dans les cataclysmes du XXe siècle. Les affirmations nationales ayant pris des formes aussi destructrices, c’est la nation qui a été mise en accusation. Parallèlement, l’Europe a été confrontée à un mouvement qu’Aristote appelait la « démocratie extrême » et que nous appelons la vague de Mai-68, c’est-à-dire une réinterprétation de la démocratie où l’idée de se gouverner soi-même en tant que collectif est abandonnée au profit d’une compréhension purement individuelle de l’existence, avec ce choix caractéristique des sociétés contemporaines de l’individu contre le citoyen. A cette dépossession progressive des nations européennes, l’Europe a opposé une compensation largement illusoire en interprétant ses retraites successives comme autant de progrès dans la construction européenne. Les renoncements consentis étant finalement mis au service d’une innovation historique considérable, la production d’un corps politique et d’un ensemble humain, tous deux inédits, qui nous feraient échapper à la fatalité guerrière de la politique européenne et où les considérations de puissance seraient rejetées dans le passé.
Pourquoi, dans ces conditions, continuer à parler comme vous le faites de dynamique de l’Occident, puisqu’une telle dynamique semble grippée ?
Nous nous trouvons au milieu d’une zone dépressionnaire. Dans la dernière période, la dynamique de l’Occident a été soutenue principalement par les Etats-Unis d’Amérique, dernière nation européenne.
Cela voudrait-il dire que l’Occident s’est en quelque sorte délocalisé ?
Le mouvement occidental, après s’être déployé en Europe, s’est projeté aux États-Unis, qui rencontrent aujourd’hui les limites de leur puissance. Si l’Europe veut garder la maîtrise de son destin, elle, qui a vécu à l’ombre des États-Unis, va être obligée d’agir politiquement. La montée en puissance d’Etats non occidentaux, l’affaiblissement relatif des États-Unis vont la placer devant des enjeux majeurs. Comment va-t-elle réagir ? Nul ne le sait. Je suis très surpris de la léthargie des Européens qui semblent consentir à leur propre disparition. Pis : ils interprètent cette disparition comme la preuve de leur supériorité morale.
Vous dites que le propre de l’Occident aura été de « déployer le plus complètement possible les possibilités de l’âme ». N’avez-vous pas le sentiment que cette âme, elle aussi, s’étiole ?
D’un individu qui s’est beaucoup dépensé, les Anglo- Saxons disent qu’il est burn-out, « épuisé, éteint ». Cela vaut des grands mouvements historiques, qui rencontrent eux aussi des phases d’épuisement. Il est certain que l’Occident a déployé des énergies prodigieuses en accouchant de formes de vie aussi variées que fécondes, la cité grecque, l’Empire romain, les nations européennes, l’Eglise. Toutes ces expressions de l’âme humaine témoignent de la richesse productive de l’Occident. On peut dire effectivement: ce fut grand, ce fut beau, mais ce chapitre de l’histoire est clos. Pourquoi pas ? Mais avant de s’y résigner, essayons de voir s’il ne serait pas possible de poursuivre l’aventure. Nous sommes toujours des hommes, les possibilités de déploiement de l’âme humaine n’ont pas disparu.

 A la Une
A la Une









 “Je suis très surpris de la léthargie des Européens, qui semblent consentir à leur propre disparition”
“Je suis très surpris de la léthargie des Européens, qui semblent consentir à leur propre disparition”