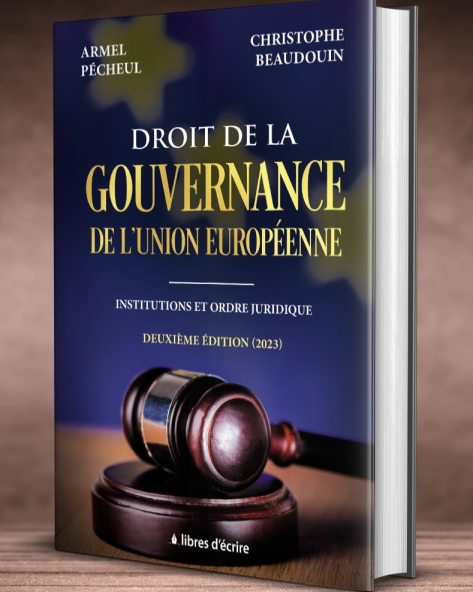par Christophe Beaudouin*
Permettez-moi de reprendre la célèbre définition que Montesquieu donne en ouverture de L’Esprit des lois : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses : et en ce sens tous les êtres ont leurs lois : la divinité a ses lois ; le monde matériel et animal a ses lois ; l’Homme a ses lois. Ces trois types de lois ont en commun l’idée d’un rapport nécessaire ». Pour Montesquieu donc, les lois expriment un rapport : rapport à Dieu, rapport à la nature, rapport à l’Homme.
Se demander aujourd’hui « comment écrit-on la loi ? » traduit, au regard de cette définition, une intuition, et j’ajouterais une angoisse. L’intuition que le rapport a changé. Que la loi n’est plus pensée ni écrite aujourd’hui comme hier. Qu’elle n’a peut-être plus la même source, la même forme, le même objet, ni les mêmes perspectives. L’angoisse de découvrir, derrière cette question énorme, non pas que la loi s’est simplement ajustée, mais que le « mouvement démocratique » conduit, ici comme ailleurs, à un véritable renversement.
La pensée juridique commune est issue d’auteurs – comme Kelsen – qui publièrent au milieu du XXème siècle. L’ordre juridique était essentiellement fondé sur la loi comme commandement impératif et unilatéral. Elle s’imposait naturellement car reçue comme légitime, au besoin par la contrainte.
Dans cet ordre international né de la paix de Westphalie, était préservée : à l’extérieur la souveraineté égale des peuples, à l’intérieur la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes. C’était un univers de distinctions et de hiérarchies. Tout le droit s’ordonnançait autour de grandes dichotomies : national ou étranger, public ou privé, droit naturel ou droit positif, droit ou fait, lettre ou esprit. Le système de pouvoir y était arborescent, à partir d’un foyer originel unique de création du droit, dont le sommet était la Constitution et, à travers elle, la volonté du souverain. Cet univers pyramidal est celui où régnaient les concepts d’État-nation, de souveraineté, de territoire, de frontières et d’intérêt général.
Puis un jour cet univers s’est mis à trembler.
Avec les progrès scientifiques et technologique, la révolution industrielle, l’aspiration croissante à l’autonomie et à l’égalité, l’Homme occidental s’est mis peu à peu à refuser l’idée même de limites. Le rêve démocratique s’est transformé en obsession d’échapper à toutes les contraintes biologiques et sociales. Au nom d’une nouvelle foi : la foi en la Science et au Progrès.
Alors les distinctions ont commencé à se brouiller à mesure que les frontières devenaient poreuses ; les hiérarchies ont commencé à être contestées à mesure où l’ordre apparaissait insupportable à l’aspiration égalitaire absolue. Déjà, Einstein élaborait sa théorie de la relativité…
Nous voici donc en marche vers un avenir radieux où chacun ne serait soumis qu’aux limites qu’il se fixe librement. Dans la déclinaison « de droite », cela implique la déréglementation économique intégrale et la mise en concurrence de tous avec tous. Dans la déclinaison « de gauche », cela implique déréglementation juridique complète du droit civil et la multiplication sans limite des droits subjectifs.
D’où une métamorphose totale du rôle et du sens de la loi. Contrairement à la loi divine ou à la loi de la République, la loi post-moderne ne tire pas sa force de valeurs partagées, d’un devoir-être ordonné à une idée partagée du Bien commun. Tout cela est renvoyé à la sphère privée. A part celle qui proclame les droits de l’Homme, la loi est peu à peu réduite à une technique vide de sens, à une norme technique destinée à faciliter le mouvement perpétuel des marchandises, des capitaux, des individus et des mœurs. Il s’ensuit, en Occident, une profonde transformation de l’Etat et du droit moderne, que l’on peut qualifier de « mutation génétique ».
Certes notre Constitution porte toujours la marque de d’ordre ancien : L’article 6 de la Déclaration de 1789 affirme toujours : « La loi est l'expression de la volonté générale.». La Constitution affirme toujours, en son article 3 que « la Souveraineté nationale appartient au peuple ». Elle pose toujours que « le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2). La justice, elle, est toujours rendue « au nom du peuple français ».
« Volonté générale », « souveraineté nationale », « République », « peuple » : ces références à un principe transcendant peuvent bien être multipliées dans notre texte constitutionnel, la loi est de moins en moins écrite à partir d’un référent extérieur à l’individu, d’un Tiers garant : Dieu, la nature ou le peuple souverain.
Nous sommes passés du gouvernement à la gouvernance, de la réglementation à la régulation, de la pyramide au réseau. Les mots n’apparaissant jamais par hasard, il s’agit bien ici de formuler quelque chose d’inédit.
La régulation oblige ainsi à distinguer clairement les fonctions d’ « opérateur » - celui qui a le pouvoir d’agir – et de « régulateur » - celui qui a l’autorité sur cet opérateur. L’État keynésien également État-providence ne pouvait être à la fois régulateur et opérateur sans fausser la concurrence.
Il a donc fallu créer partout des autorités indépendantes chargées de la fonction de régulation – donc émettrices de normes - en lieu et place de l’État : dans l’électricité, les télécoms, la télévision, la bourse, le médicament, la santé, l’hospitalisation, l’informatique, etc. Il faut y ajouter les comités d’éthique et naturellement, s’agissant de la régulation du marché : la Commission européenne et l’Organisation mondiale du commerce, autorités régulatrices très puissantes. C’est un véritable droit global produit par une administration globale qui a émergé.
Il existe aujourd’hui plus de 2000 organisations de niveau mondial, plus de 100 tribunaux internationaux, une centaine d’organes quasi-juridictionnels et des centaines de normes d’application universelle qui s’adressent non seulement aux États, aux administrations mais aussi aux particuliers directement. Ces organes et ces normes ignorent peu de domaines : le commerce des biens et des services, le transport aérien, l’environnement, l’espace, la défense, le transport ferroviaire, la mer, la santé, les épidémies, la police, la monnaie, l’alimentation, la poste, les énergies, la climatologie, le droit du travail, l’Internet, les sciences, les ressources marines, les contrats publics, le terrorisme, les politiques sociales…
Cet ordre global en gestation a fait de l’Union européenne son laboratoire expérimental le plus avancé. Elle se présente déjà comme réseau polycentrique : réseau judiciaire reliant la Cour de justice et la Cour des droits de l’Homme aux juges nationaux ; réseau exécutif autour des Conseils ministres, du Conseil européen, de la Commission et prolongé dans les écheveaux de la comitologie ; réseau parlementaire encore balbutiant ; réseau d’influence avec les lobbies, syndicats et autres ONG.
Le volume de droit impératif et immédiat conçu au sein de ce réseau mérite d’être souligné : 10200 règlements, 1890 directives, 9400 arrêts de la CJUE, auxquels il faut ajouter plus de 33000 arrêts de la CEDH (dont 850 arrêts de violation concernent la France). Au total, 80 à 90% des lois nouvelles en sont issues.
Plusieurs grandes caractéristiques distinguent ce droit global du droit national ou international issu de l’ordre westphalien :
1) Alors que le droit national tourne autour d’un seul pôle – l’État – le droit global est multipolaire. C’est bien le cas du droit européen. La production normative se déroule non sur décision unilatérale d’une autorité centrale, mais au terme de consultations, négociations, trilogues avec des entités et organes placés sur un même plan, ressemblant à un marchandage permanent permettant les compromis. Les experts, lobbies, représentants auto-désignés de la « société civile » qui interviennent à tous les stades de la conception à l’application, le Parlement européen avec ses hyper-majorités caractéristiques du compromis permanent, en codécision avec les Conseils ratifiant à la majorité qualifiée les projets de la Commission, pré-adoptés par le COREPER, instance où la loi est négociée entre fonctionnaires de la Commission et diplomates. L’ensemble du processus étant intégralement maîtrisé par la Commission européenne depuis le monopole de l’initiative des textes, jusqu’à la rédaction des actes d’exécution.
2) Le pouvoir normatif est omniprésent dans l’ordre global, avec un grand nombre de prescriptions et donc de normes. Mais pouvoir exécutif y est moins développé que dans un État et, comme dans l’Union européenne, il s’en remet donc aux exécutifs nationaux, à leurs administrations et juridictions. L’expression « États membres » doit donc être comprise au sens organique de « démembrement ». C’est l’indirect rule – l’administration indirecte - : les normes et tâches de l’ordre global sont exécutées par les organes nationaux, ce qui lui permet de détenir le pouvoir décisionnaire malgré une dimension administrative et budgétaire modeste. L’administration et le budget de l’Union sont d’ailleurs incomparables à ceux de l’administration fédérale des États-Unis, qui sont précisément un État-nation.Le droit global est composite. Ainsi, le droit européen exige non seulement que les droits nationaux se conforment à lui, mais il les met en communication directe, en concurrence les uns avec les autres, favorisant le law shopping (marché des normes), pour choisir le droit le plus « favorable » au sens du marché par-dessus les frontières.Cette mise en concurrence des législations s’opère à travers la libre circulation des capitaux, des marchandises, des individus et des services principalement, ainsi qu’à travers la reconnaissance mutuelle des différents ordres nationaux.
3) Le droit international est dominé par une conception dualiste interposant l’Etat, jusqu’alors seul sujet de droit international, entre le droit international et le droit interne. Avec le droit global, au contraire, ce rôle d’écran est atténué ou supprimé : il est soumis lui-même au droit global (primauté le droit national), il n’est plus le seul sujet de droit international (effet direct), l’Union a la personnalité juridique (elle remplace les Etats à l’OMC et a déjà un siège d’observateur à l’ONU) et une « citoyenneté européenne » vient s’ajouter à la citoyenneté nationale.
4) Le droit national impose aux citoyens des obligations et des droits, cherchant à équilibrer l’autorité de l’État et la liberté des personnes. Le droit global lui a plutôt pour objet et pour effet d’augmenter les libertés subjectives des individus, minorités, groupements d’intérêts et des entreprises, en imposant des limites à l’action des États.
5) L’explosion et la technicité de ces normes contribuent à une forme de dénaturation du droit, préjudiciable à l’État de droit. À la loi impérative, perpétuelle, claire, générale et parcimonieuse se substitue donc peu à peu la loi négociée ou dont l’opportunité de l’application peut s’apprécier, expérimentale, cédant souvent à la confusion, à la spécialisation technique, à l’inflation et à la prolixité. C’est notamment le fait de la montée en puissance du « droit mou »: communications, lignes directrices, résolutions – cela représente quelques 12.000 documents de la Commission et du Parlement, souvent hors de leur domaine de compétence. Cette dénaturation résulte aussi de la montée en force de la normalisation technique (normes de qualité, certification) y compris dans les actes législatifs européens – 15.000 actes consolidés à ce jour. Elle traduit enfin la mutation de la loi qui résulte moins de la recherche de l’intérêt général par la dispute démocratique, que de la négociation permanente et du compromis entre intérêts particuliers.
Coupé de sa formulation politique, de sa source démocratique – le kratos par le demos - et de la recherche du Bien commun, le droit global, privé d'une pleine légitimité, ne s’expose-t-il pas au risque de désobéissance ? Certains n’hésitent pas à se demander même s’il s’agit encore de droit. Songeons donc, avant de nous quitter, à la mise en garde de Saint-Augustin : « Si l’on supprime le droit, alors qu’est-ce qui distinguera le pouvoir d’une vaste de bande de brigands ? »
*Docteur en droit public, conseiller au Parlement européen. Cette Communication a été présentée par son auteur le 19 mars 2014 lors d’une conférence dans le cadre du cycle « Droit et Philosophie » organisée au Collège Supérieur de Lyon sur le thème "Comment s'écrit la loi?".
Pour aller plus loin :
Christophe BEAUDOUIN, La démocratie à l’épreuve de l’intégration européenne, LGDJ, 2014
Sabino CASSESE, Au-delà de l’État, Bruylant, 2011
Dominique SCHNAPPER, L’esprit démocratique des lois, Gallimard, 2014
Alain SUPIOT, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005
Se demander aujourd’hui « comment écrit-on la loi ? » traduit, au regard de cette définition, une intuition, et j’ajouterais une angoisse. L’intuition que le rapport a changé. Que la loi n’est plus pensée ni écrite aujourd’hui comme hier. Qu’elle n’a peut-être plus la même source, la même forme, le même objet, ni les mêmes perspectives. L’angoisse de découvrir, derrière cette question énorme, non pas que la loi s’est simplement ajustée, mais que le « mouvement démocratique » conduit, ici comme ailleurs, à un véritable renversement.
La pensée juridique commune est issue d’auteurs – comme Kelsen – qui publièrent au milieu du XXème siècle. L’ordre juridique était essentiellement fondé sur la loi comme commandement impératif et unilatéral. Elle s’imposait naturellement car reçue comme légitime, au besoin par la contrainte.
Dans cet ordre international né de la paix de Westphalie, était préservée : à l’extérieur la souveraineté égale des peuples, à l’intérieur la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes. C’était un univers de distinctions et de hiérarchies. Tout le droit s’ordonnançait autour de grandes dichotomies : national ou étranger, public ou privé, droit naturel ou droit positif, droit ou fait, lettre ou esprit. Le système de pouvoir y était arborescent, à partir d’un foyer originel unique de création du droit, dont le sommet était la Constitution et, à travers elle, la volonté du souverain. Cet univers pyramidal est celui où régnaient les concepts d’État-nation, de souveraineté, de territoire, de frontières et d’intérêt général.
Puis un jour cet univers s’est mis à trembler.
Avec les progrès scientifiques et technologique, la révolution industrielle, l’aspiration croissante à l’autonomie et à l’égalité, l’Homme occidental s’est mis peu à peu à refuser l’idée même de limites. Le rêve démocratique s’est transformé en obsession d’échapper à toutes les contraintes biologiques et sociales. Au nom d’une nouvelle foi : la foi en la Science et au Progrès.
Alors les distinctions ont commencé à se brouiller à mesure que les frontières devenaient poreuses ; les hiérarchies ont commencé à être contestées à mesure où l’ordre apparaissait insupportable à l’aspiration égalitaire absolue. Déjà, Einstein élaborait sa théorie de la relativité…
Nous voici donc en marche vers un avenir radieux où chacun ne serait soumis qu’aux limites qu’il se fixe librement. Dans la déclinaison « de droite », cela implique la déréglementation économique intégrale et la mise en concurrence de tous avec tous. Dans la déclinaison « de gauche », cela implique déréglementation juridique complète du droit civil et la multiplication sans limite des droits subjectifs.
D’où une métamorphose totale du rôle et du sens de la loi. Contrairement à la loi divine ou à la loi de la République, la loi post-moderne ne tire pas sa force de valeurs partagées, d’un devoir-être ordonné à une idée partagée du Bien commun. Tout cela est renvoyé à la sphère privée. A part celle qui proclame les droits de l’Homme, la loi est peu à peu réduite à une technique vide de sens, à une norme technique destinée à faciliter le mouvement perpétuel des marchandises, des capitaux, des individus et des mœurs. Il s’ensuit, en Occident, une profonde transformation de l’Etat et du droit moderne, que l’on peut qualifier de « mutation génétique ».
Certes notre Constitution porte toujours la marque de d’ordre ancien : L’article 6 de la Déclaration de 1789 affirme toujours : « La loi est l'expression de la volonté générale.». La Constitution affirme toujours, en son article 3 que « la Souveraineté nationale appartient au peuple ». Elle pose toujours que « le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2). La justice, elle, est toujours rendue « au nom du peuple français ».
« Volonté générale », « souveraineté nationale », « République », « peuple » : ces références à un principe transcendant peuvent bien être multipliées dans notre texte constitutionnel, la loi est de moins en moins écrite à partir d’un référent extérieur à l’individu, d’un Tiers garant : Dieu, la nature ou le peuple souverain.
Nous sommes passés du gouvernement à la gouvernance, de la réglementation à la régulation, de la pyramide au réseau. Les mots n’apparaissant jamais par hasard, il s’agit bien ici de formuler quelque chose d’inédit.
La régulation oblige ainsi à distinguer clairement les fonctions d’ « opérateur » - celui qui a le pouvoir d’agir – et de « régulateur » - celui qui a l’autorité sur cet opérateur. L’État keynésien également État-providence ne pouvait être à la fois régulateur et opérateur sans fausser la concurrence.
Il a donc fallu créer partout des autorités indépendantes chargées de la fonction de régulation – donc émettrices de normes - en lieu et place de l’État : dans l’électricité, les télécoms, la télévision, la bourse, le médicament, la santé, l’hospitalisation, l’informatique, etc. Il faut y ajouter les comités d’éthique et naturellement, s’agissant de la régulation du marché : la Commission européenne et l’Organisation mondiale du commerce, autorités régulatrices très puissantes. C’est un véritable droit global produit par une administration globale qui a émergé.
Il existe aujourd’hui plus de 2000 organisations de niveau mondial, plus de 100 tribunaux internationaux, une centaine d’organes quasi-juridictionnels et des centaines de normes d’application universelle qui s’adressent non seulement aux États, aux administrations mais aussi aux particuliers directement. Ces organes et ces normes ignorent peu de domaines : le commerce des biens et des services, le transport aérien, l’environnement, l’espace, la défense, le transport ferroviaire, la mer, la santé, les épidémies, la police, la monnaie, l’alimentation, la poste, les énergies, la climatologie, le droit du travail, l’Internet, les sciences, les ressources marines, les contrats publics, le terrorisme, les politiques sociales…
Cet ordre global en gestation a fait de l’Union européenne son laboratoire expérimental le plus avancé. Elle se présente déjà comme réseau polycentrique : réseau judiciaire reliant la Cour de justice et la Cour des droits de l’Homme aux juges nationaux ; réseau exécutif autour des Conseils ministres, du Conseil européen, de la Commission et prolongé dans les écheveaux de la comitologie ; réseau parlementaire encore balbutiant ; réseau d’influence avec les lobbies, syndicats et autres ONG.
Le volume de droit impératif et immédiat conçu au sein de ce réseau mérite d’être souligné : 10200 règlements, 1890 directives, 9400 arrêts de la CJUE, auxquels il faut ajouter plus de 33000 arrêts de la CEDH (dont 850 arrêts de violation concernent la France). Au total, 80 à 90% des lois nouvelles en sont issues.
Plusieurs grandes caractéristiques distinguent ce droit global du droit national ou international issu de l’ordre westphalien :
1) Alors que le droit national tourne autour d’un seul pôle – l’État – le droit global est multipolaire. C’est bien le cas du droit européen. La production normative se déroule non sur décision unilatérale d’une autorité centrale, mais au terme de consultations, négociations, trilogues avec des entités et organes placés sur un même plan, ressemblant à un marchandage permanent permettant les compromis. Les experts, lobbies, représentants auto-désignés de la « société civile » qui interviennent à tous les stades de la conception à l’application, le Parlement européen avec ses hyper-majorités caractéristiques du compromis permanent, en codécision avec les Conseils ratifiant à la majorité qualifiée les projets de la Commission, pré-adoptés par le COREPER, instance où la loi est négociée entre fonctionnaires de la Commission et diplomates. L’ensemble du processus étant intégralement maîtrisé par la Commission européenne depuis le monopole de l’initiative des textes, jusqu’à la rédaction des actes d’exécution.
2) Le pouvoir normatif est omniprésent dans l’ordre global, avec un grand nombre de prescriptions et donc de normes. Mais pouvoir exécutif y est moins développé que dans un État et, comme dans l’Union européenne, il s’en remet donc aux exécutifs nationaux, à leurs administrations et juridictions. L’expression « États membres » doit donc être comprise au sens organique de « démembrement ». C’est l’indirect rule – l’administration indirecte - : les normes et tâches de l’ordre global sont exécutées par les organes nationaux, ce qui lui permet de détenir le pouvoir décisionnaire malgré une dimension administrative et budgétaire modeste. L’administration et le budget de l’Union sont d’ailleurs incomparables à ceux de l’administration fédérale des États-Unis, qui sont précisément un État-nation.Le droit global est composite. Ainsi, le droit européen exige non seulement que les droits nationaux se conforment à lui, mais il les met en communication directe, en concurrence les uns avec les autres, favorisant le law shopping (marché des normes), pour choisir le droit le plus « favorable » au sens du marché par-dessus les frontières.Cette mise en concurrence des législations s’opère à travers la libre circulation des capitaux, des marchandises, des individus et des services principalement, ainsi qu’à travers la reconnaissance mutuelle des différents ordres nationaux.
3) Le droit international est dominé par une conception dualiste interposant l’Etat, jusqu’alors seul sujet de droit international, entre le droit international et le droit interne. Avec le droit global, au contraire, ce rôle d’écran est atténué ou supprimé : il est soumis lui-même au droit global (primauté le droit national), il n’est plus le seul sujet de droit international (effet direct), l’Union a la personnalité juridique (elle remplace les Etats à l’OMC et a déjà un siège d’observateur à l’ONU) et une « citoyenneté européenne » vient s’ajouter à la citoyenneté nationale.
4) Le droit national impose aux citoyens des obligations et des droits, cherchant à équilibrer l’autorité de l’État et la liberté des personnes. Le droit global lui a plutôt pour objet et pour effet d’augmenter les libertés subjectives des individus, minorités, groupements d’intérêts et des entreprises, en imposant des limites à l’action des États.
5) L’explosion et la technicité de ces normes contribuent à une forme de dénaturation du droit, préjudiciable à l’État de droit. À la loi impérative, perpétuelle, claire, générale et parcimonieuse se substitue donc peu à peu la loi négociée ou dont l’opportunité de l’application peut s’apprécier, expérimentale, cédant souvent à la confusion, à la spécialisation technique, à l’inflation et à la prolixité. C’est notamment le fait de la montée en puissance du « droit mou »: communications, lignes directrices, résolutions – cela représente quelques 12.000 documents de la Commission et du Parlement, souvent hors de leur domaine de compétence. Cette dénaturation résulte aussi de la montée en force de la normalisation technique (normes de qualité, certification) y compris dans les actes législatifs européens – 15.000 actes consolidés à ce jour. Elle traduit enfin la mutation de la loi qui résulte moins de la recherche de l’intérêt général par la dispute démocratique, que de la négociation permanente et du compromis entre intérêts particuliers.
Coupé de sa formulation politique, de sa source démocratique – le kratos par le demos - et de la recherche du Bien commun, le droit global, privé d'une pleine légitimité, ne s’expose-t-il pas au risque de désobéissance ? Certains n’hésitent pas à se demander même s’il s’agit encore de droit. Songeons donc, avant de nous quitter, à la mise en garde de Saint-Augustin : « Si l’on supprime le droit, alors qu’est-ce qui distinguera le pouvoir d’une vaste de bande de brigands ? »
*Docteur en droit public, conseiller au Parlement européen. Cette Communication a été présentée par son auteur le 19 mars 2014 lors d’une conférence dans le cadre du cycle « Droit et Philosophie » organisée au Collège Supérieur de Lyon sur le thème "Comment s'écrit la loi?".
Pour aller plus loin :
Christophe BEAUDOUIN, La démocratie à l’épreuve de l’intégration européenne, LGDJ, 2014
Sabino CASSESE, Au-delà de l’État, Bruylant, 2011
Dominique SCHNAPPER, L’esprit démocratique des lois, Gallimard, 2014
Alain SUPIOT, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005

 A la Une
A la Une









 Du gouvernement à la gouvernance : comment s'écrit la loi aujourd'hui ?
Du gouvernement à la gouvernance : comment s'écrit la loi aujourd'hui ?