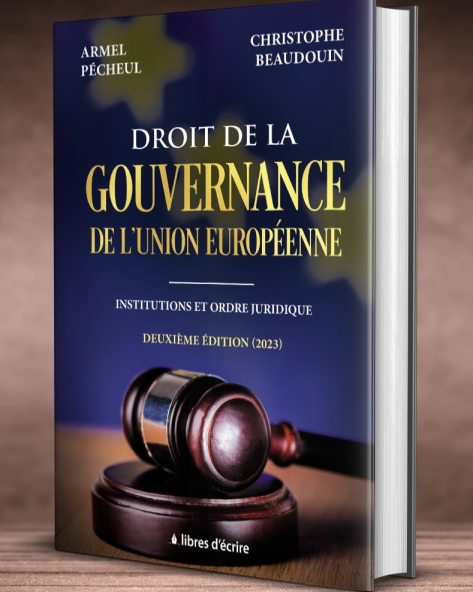CONFERENCE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION DEMOGRAPHIQUE - SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE – 29 NOVEMBRE 2013
Les Européens devant leur déclin démographique
par Christophe BEAUDOUIN, Docteur en droit
Madame le Ministre,
Madame la directrice générale,
Cher Ignacio Socias,
Mesdames, Messieurs,
Remerciements -
Nous vivons une folle période d’insouciance démographique. Alors que la catastrophe est programmée noir sur blanc, depuis le milieu des années 70, dans notre pyramide des âges. En Europe, un nombre de femmes de plus en plus restreint met au monde de moins en moins d’enfants et de plus en plus tardivement.
La situation démographique européenne se caractérise par quatre éléments: l'allongement de l'espérance de vie, le faible nombre moyen d'enfants par femme (1,5 pour l'Europe à 27 alors qu’il en faudrait 2,1 pour assurer le renouvellement des générations), le fort déclin du nombre des naissances dans les récentes décennies, un flux d'immigration fort.
Le « vieux continent » n’a donc jamais si bien porté son nom, puisque c’est aujourd’hui une population vieillissante, composée à 4 % d’octogénaires (et plus). Cette proportion devrait atteindre 12 % dans un demi-siècle. Il y a quelques jours, les chiffres d’Eurostat révélaient que la population européenne a augmenté entre 2012 et 2013, mais à 80% grâce aux 900000 immigrants supplémentaires accueillis.
L’essentiel de l'augmentation de la population de l'UE est dû aujourd'hui à un solde migratoire positif.
La natalité européenne doit surtout à 5 pays : Irlande (15,7 naissances pour mille habitants), Royaume-Uni (12,8 pour mille), France (12,6 pour mille), Suède et Chypre. A l'autre bout de la chaîne, quatre pays continuent à tirer la démographie vers le bas en raison d'un taux de natalité très bas : Allemagne (8,4 pour mille), Portugal, Grèce et Italie.
Si elle est la plus touchée, l’Europe n’est pas la seule et la dénatalité est un phénomène mondial. Evacuons ainsi d’emblée quelques idées reçues sur le sujet, en nous appuyant sur les travaux du grand démographe Gérard-François Dumont.
L’humanité connaît-elle une natalité débridée ? Non : voici plusieurs décennies que les taux de natalité diminuent nettement et partout, sous l’effet de ce qu’on appelle la « transition démographique. C’est-à-dire que c’est une période durant laquelle une population voit baisser à la fois une natalité et une mortalité qui étaient auparavant très élevées.
Faut-il craindre une explosion démographique ? Non, la bombe ne sautera pas. Le phénomène majeur du XXIe siècle ne sera pas l’explosion – c’est-à-dire la croissance rapide de la population - mais son vieillissement [1].
Le vieillissement accéléré sera le grand phénomène de ce siècle ainsi que la concentration urbaine toujours plus forte.
Dans ce débat d’aujourd’hui, on m’a donc demandé d’apporter un éclairage européen.
Je vous propose d’abord un petit tour d’Europe des politiques familiales
Les défis auxquels les Européens doivent faire face convergent : baisse et report de la fécondité ; augmentation des séparations, des unions libres et des naissances hors mariage ; hausse de l’activité féminine, de la monoparentalité et des recompositions familiales ; réduction de la taille des ménages et du nombre des enfants ; vieillissement et poids grandissant de la charge des dépendants.
Si les défis sont les mêmes, les politiques, elles, divergent. Dans les pays du Sud, et plus largement dans les pays de tradition catholique, il s’agit d’intervenir en direction de la famille. Dans les pays du Nord, majoritairement protestants, les prestations correspondent plutôt à des droits dirigés individuellement vers les enfants.
La Belgique et la France avaient historiquement développé une politique familiale à visée nataliste.
L’Italie, le Portugal et l’Espagne, après leur accès à la démocratie, se sont longtemps refusés à investir expressément en ce sens, en raison de tabous hérités du passé.
Dans les pays de l’Est qui ont rejoint l’Union, les problèmes de déclin démographique ont servi à justifier la promotion de mesures familiales. Pour autant, dans ces pays qui ont fait l’expérience d’une conception de la famille annexée à l’Etat, l’aversion à l’intervention étatique dans l’espace privé peut être forte.
Dans les pays scandinaves et en France, quelle que soit la majorité politique au pouvoir, la politique familiale est hautement structurée et légitimée.
A l’inverse, au Sud et à l’Est, ce qui peut être baptisé politique familiale est souvent hésitant, sans cohérence, sans financement, et parfois contesté.
Entre ces deux pôles, on trouve des pays, incluant l’Allemagne ou le Royaume-Uni, où la rhétorique pro-familiale est désormais très présente, mais où les acteurs politiques sont toujours réticents à l’idée d’intervenir dans et sur la vie privée.
Dans le cas anglais, les très hauts niveaux de pauvreté chez les enfants ont conduit le gouvernement à investir massivement à partir de la fin des années 1990, en se fixant même l’objectif ambitieux d’éradiquer la pauvreté infantile d’ici 2020.
En Allemagne les préoccupations démographiques ont conduit les derniers gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche, à investir également fortement dans des mesures visant à aider les femmes à mieux concilier désir d’enfant et aspirations professionnelles.
Au final, les législations nationales reflètent toujours amplement des particularités historiques,
philosophiques et religieuses.
Au total, les pays qui consacrent la plus grande part de leur PIB à soutenir leur démographie sont le Danemark avec 3,88 % ; Le Luxembourg avec 3,7 % ; l’Allemagne 3,29 % ; la Suède 3,14 % ; la Finlande 3,1 % ; l'Islande 3,02 %, la Norvège 2,89 % et la France.
Les pays d’Europe du Sud et de l’Est sont à la traîne : entre 1,1 % et 1,5 % du PIB pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal, et la Grèce, la Pologne : 0,86 %, la Bulgarie: 1,09 % ou l'Estonie : 1,53 %.
Cet état des lieux européen étant posé, je tenterai de répondre devant vous aux quelques grandes questions, qui me semblent être celles qui se posent aujourd’hui aux pouvoirs publics européens confrontés au péril démographique qui menace nos économies, déjà mal en point, et l’avenir même du continent.
1. D’abord, est-ce que l’immigration est une réponse crédible au déficit démographique européen ?
2. Un pays a-t-il vraiment besoin d’une politique familiale et pourquoi ?
3. La politique familiale peut-elle suffire face au déclin démographique ?
4. Quel rôle l’Union européenne joue-t-elle et doit-elle jouer ?
par Christophe BEAUDOUIN, Docteur en droit
Madame le Ministre,
Madame la directrice générale,
Cher Ignacio Socias,
Mesdames, Messieurs,
Remerciements -
Nous vivons une folle période d’insouciance démographique. Alors que la catastrophe est programmée noir sur blanc, depuis le milieu des années 70, dans notre pyramide des âges. En Europe, un nombre de femmes de plus en plus restreint met au monde de moins en moins d’enfants et de plus en plus tardivement.
La situation démographique européenne se caractérise par quatre éléments: l'allongement de l'espérance de vie, le faible nombre moyen d'enfants par femme (1,5 pour l'Europe à 27 alors qu’il en faudrait 2,1 pour assurer le renouvellement des générations), le fort déclin du nombre des naissances dans les récentes décennies, un flux d'immigration fort.
Le « vieux continent » n’a donc jamais si bien porté son nom, puisque c’est aujourd’hui une population vieillissante, composée à 4 % d’octogénaires (et plus). Cette proportion devrait atteindre 12 % dans un demi-siècle. Il y a quelques jours, les chiffres d’Eurostat révélaient que la population européenne a augmenté entre 2012 et 2013, mais à 80% grâce aux 900000 immigrants supplémentaires accueillis.
L’essentiel de l'augmentation de la population de l'UE est dû aujourd'hui à un solde migratoire positif.
La natalité européenne doit surtout à 5 pays : Irlande (15,7 naissances pour mille habitants), Royaume-Uni (12,8 pour mille), France (12,6 pour mille), Suède et Chypre. A l'autre bout de la chaîne, quatre pays continuent à tirer la démographie vers le bas en raison d'un taux de natalité très bas : Allemagne (8,4 pour mille), Portugal, Grèce et Italie.
Si elle est la plus touchée, l’Europe n’est pas la seule et la dénatalité est un phénomène mondial. Evacuons ainsi d’emblée quelques idées reçues sur le sujet, en nous appuyant sur les travaux du grand démographe Gérard-François Dumont.
L’humanité connaît-elle une natalité débridée ? Non : voici plusieurs décennies que les taux de natalité diminuent nettement et partout, sous l’effet de ce qu’on appelle la « transition démographique. C’est-à-dire que c’est une période durant laquelle une population voit baisser à la fois une natalité et une mortalité qui étaient auparavant très élevées.
Faut-il craindre une explosion démographique ? Non, la bombe ne sautera pas. Le phénomène majeur du XXIe siècle ne sera pas l’explosion – c’est-à-dire la croissance rapide de la population - mais son vieillissement [1].
Le vieillissement accéléré sera le grand phénomène de ce siècle ainsi que la concentration urbaine toujours plus forte.
Dans ce débat d’aujourd’hui, on m’a donc demandé d’apporter un éclairage européen.
Je vous propose d’abord un petit tour d’Europe des politiques familiales
Les défis auxquels les Européens doivent faire face convergent : baisse et report de la fécondité ; augmentation des séparations, des unions libres et des naissances hors mariage ; hausse de l’activité féminine, de la monoparentalité et des recompositions familiales ; réduction de la taille des ménages et du nombre des enfants ; vieillissement et poids grandissant de la charge des dépendants.
Si les défis sont les mêmes, les politiques, elles, divergent. Dans les pays du Sud, et plus largement dans les pays de tradition catholique, il s’agit d’intervenir en direction de la famille. Dans les pays du Nord, majoritairement protestants, les prestations correspondent plutôt à des droits dirigés individuellement vers les enfants.
La Belgique et la France avaient historiquement développé une politique familiale à visée nataliste.
L’Italie, le Portugal et l’Espagne, après leur accès à la démocratie, se sont longtemps refusés à investir expressément en ce sens, en raison de tabous hérités du passé.
Dans les pays de l’Est qui ont rejoint l’Union, les problèmes de déclin démographique ont servi à justifier la promotion de mesures familiales. Pour autant, dans ces pays qui ont fait l’expérience d’une conception de la famille annexée à l’Etat, l’aversion à l’intervention étatique dans l’espace privé peut être forte.
Dans les pays scandinaves et en France, quelle que soit la majorité politique au pouvoir, la politique familiale est hautement structurée et légitimée.
A l’inverse, au Sud et à l’Est, ce qui peut être baptisé politique familiale est souvent hésitant, sans cohérence, sans financement, et parfois contesté.
Entre ces deux pôles, on trouve des pays, incluant l’Allemagne ou le Royaume-Uni, où la rhétorique pro-familiale est désormais très présente, mais où les acteurs politiques sont toujours réticents à l’idée d’intervenir dans et sur la vie privée.
Dans le cas anglais, les très hauts niveaux de pauvreté chez les enfants ont conduit le gouvernement à investir massivement à partir de la fin des années 1990, en se fixant même l’objectif ambitieux d’éradiquer la pauvreté infantile d’ici 2020.
En Allemagne les préoccupations démographiques ont conduit les derniers gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche, à investir également fortement dans des mesures visant à aider les femmes à mieux concilier désir d’enfant et aspirations professionnelles.
Au final, les législations nationales reflètent toujours amplement des particularités historiques,
philosophiques et religieuses.
Au total, les pays qui consacrent la plus grande part de leur PIB à soutenir leur démographie sont le Danemark avec 3,88 % ; Le Luxembourg avec 3,7 % ; l’Allemagne 3,29 % ; la Suède 3,14 % ; la Finlande 3,1 % ; l'Islande 3,02 %, la Norvège 2,89 % et la France.
Les pays d’Europe du Sud et de l’Est sont à la traîne : entre 1,1 % et 1,5 % du PIB pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal, et la Grèce, la Pologne : 0,86 %, la Bulgarie: 1,09 % ou l'Estonie : 1,53 %.
Cet état des lieux européen étant posé, je tenterai de répondre devant vous aux quelques grandes questions, qui me semblent être celles qui se posent aujourd’hui aux pouvoirs publics européens confrontés au péril démographique qui menace nos économies, déjà mal en point, et l’avenir même du continent.
1. D’abord, est-ce que l’immigration est une réponse crédible au déficit démographique européen ?
2. Un pays a-t-il vraiment besoin d’une politique familiale et pourquoi ?
3. La politique familiale peut-elle suffire face au déclin démographique ?
4. Quel rôle l’Union européenne joue-t-elle et doit-elle jouer ?
(1) Il peut être mesuré soit par l’augmentation de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus (5,2 % en 1950, 7,6 % en 2010 et 16,2 % en 2050 selon les prévisions de l’ONU , soit par l’évolution de l’âge médian (24 ans en 1950, 29 ans en 2010 et environ 38 ans en 2050
I - Les politiques d'immigrations compensent-elles le déficit démographique ?
Comme les États-Unis ou le Canada, également touchés par le vieillissement, l’Europe voit sa population continuer à augmenter grâce à un flux d'immigration important. Au niveau européen, on estime que la population immigrée représente en moyenne de 9 à 10% de la population totale de l'UE.
Les experts des grandes institutions supranationales veulent encourager cette immigration familiale extra-européenne et proposent des apports migratoires massifs : la Commission a publié plusieurs Livres verts et émis des propositions en ce sens.
Croire que les apports migratoires massifs résoudront le problème de l’Europe est une vision très comptable, de celles qui conduisent systématiquement dans l’impasse, faute d’appréhender la réalité humaine dans sa complexité.
D’abord parce qu’il faudrait que ce soit une immigration très massive – plus du double des entrées actuelles – et composée de populations jeunes et fécondes afin d’atteindre le seuil de simple remplacement des générations. Or, l’expérience montre qu’une fois installées en Europe, ces populations réduisent en une ou deux générations leur fécondité.
Ensuite et surtout en raison de la crise aigüe de l’intégration des nouveaux venus, crise dont la responsabilité est d’ailleurs largement partagée entre ceux-ci et la société d’accueil.
Les experts et institutions supranationales qui, avec leur pauvre calculette en main, prétendent que des afflux d’immigrés compenseront la dénatalité européenne se trompent. Ils comptent les hommes comme ils comptent les carottes ou du bétail. Ils croient que les individus sont interchangeables.
Mais les hommes ne sont pas interchangeables. Et les modes de vie différents de ces individus différents peuvent se heurter et la situation dégénérer, au prix de la paix sociale voire de la paix civile. Ecoutons le philosophe Alain Finkelkraut : « Aussi identiquement soumis soient-ils à la logique de l’intérêt, ils ne sont pas coulés dans le même moule, ils n’ont pas la même manière d’habiter ni de comprendre le monde. Aucune de ces différences n’est immuable. Aucune n’est insurmontable. Toutes ne sont pas non plus antagoniques. Mais quand, sous la mince pellicule d’universalité dont l’industrie du divertissement, les grandes compétitions sportives, les jeans et les sodas recouvrent la terre, les modes de vie se heurtent, la crise éclate. » (« L’identité malheureuse, 2013, Flammarion, p22)
Une société multiculturelle devient vite une société multiconflictuelle.
Par une augmentation de l’immigration telle que proposée par la Commission européenne, non seulement on ne résoudra pas le problème crucial de remplacement des générations européennes, mais on accentuera les tensions internes qui travaillent déjà les sociétés européennes.
Le principe multiculturel promeut un modèle de construction sociale qui s’oppose pied à pied au modèle d’homogénéité sociale et politique sur lequel reposent les États-nations. (1) Le processus actuel de globalisation suscite une redéfinition du lien entre la culture d’appartenance et la liberté individuelle. La question de la conscience politique européenne et donc de la citoyenneté se pose aujourd’hui dans les termes suivants : à partir de quels critères l’individu va-t-il faire librement des choix qui ont un sens à ses yeux, dans un contexte culturel qui ne serait plus celui fourni par l’État-nation, chargé jusqu’ici de fournir à chacun, quelles que soient son origine, sa race ou sa religion, une mémoire collective et un projet commun, autrement dit les références partagées à partir desquelles un cadre politique est possible ?
Le multiculturalisme porte une nouvelle conception, où le « vivre ensemble » est réduit à un « vivre côte à côte » et l’idéal d’intégration réduit à la « tolérance » (du latin tolerare : « supporter »). Selon cette conception en réalité méfiante et négative à l’égard de celui qui est « différent », l’égalité et la liberté ne s’acquièrent plus par l’assimilation – qui met au second plan la différence ethnique ou religieuse au profit du « plébiscite de tous les jours » d’individus choisissant de faire partie d’une communauté d’Histoire et de destin – mais au contraire, par l’affirmation de cette différence en tant que source de normes spécifiques soustrayant l’individu à la loi commune, au projet commun et donc à la communauté nationale.
L’Europe serait mieux inspirer de renouer avec son identité, de retrouver les racines multiples et riches de la civilisation européenne et d’aller chercher en elle-même les moyens de son sursaut vital.
Les experts des grandes institutions supranationales veulent encourager cette immigration familiale extra-européenne et proposent des apports migratoires massifs : la Commission a publié plusieurs Livres verts et émis des propositions en ce sens.
Croire que les apports migratoires massifs résoudront le problème de l’Europe est une vision très comptable, de celles qui conduisent systématiquement dans l’impasse, faute d’appréhender la réalité humaine dans sa complexité.
D’abord parce qu’il faudrait que ce soit une immigration très massive – plus du double des entrées actuelles – et composée de populations jeunes et fécondes afin d’atteindre le seuil de simple remplacement des générations. Or, l’expérience montre qu’une fois installées en Europe, ces populations réduisent en une ou deux générations leur fécondité.
Ensuite et surtout en raison de la crise aigüe de l’intégration des nouveaux venus, crise dont la responsabilité est d’ailleurs largement partagée entre ceux-ci et la société d’accueil.
Les experts et institutions supranationales qui, avec leur pauvre calculette en main, prétendent que des afflux d’immigrés compenseront la dénatalité européenne se trompent. Ils comptent les hommes comme ils comptent les carottes ou du bétail. Ils croient que les individus sont interchangeables.
Mais les hommes ne sont pas interchangeables. Et les modes de vie différents de ces individus différents peuvent se heurter et la situation dégénérer, au prix de la paix sociale voire de la paix civile. Ecoutons le philosophe Alain Finkelkraut : « Aussi identiquement soumis soient-ils à la logique de l’intérêt, ils ne sont pas coulés dans le même moule, ils n’ont pas la même manière d’habiter ni de comprendre le monde. Aucune de ces différences n’est immuable. Aucune n’est insurmontable. Toutes ne sont pas non plus antagoniques. Mais quand, sous la mince pellicule d’universalité dont l’industrie du divertissement, les grandes compétitions sportives, les jeans et les sodas recouvrent la terre, les modes de vie se heurtent, la crise éclate. » (« L’identité malheureuse, 2013, Flammarion, p22)
Une société multiculturelle devient vite une société multiconflictuelle.
Par une augmentation de l’immigration telle que proposée par la Commission européenne, non seulement on ne résoudra pas le problème crucial de remplacement des générations européennes, mais on accentuera les tensions internes qui travaillent déjà les sociétés européennes.
Le principe multiculturel promeut un modèle de construction sociale qui s’oppose pied à pied au modèle d’homogénéité sociale et politique sur lequel reposent les États-nations. (1) Le processus actuel de globalisation suscite une redéfinition du lien entre la culture d’appartenance et la liberté individuelle. La question de la conscience politique européenne et donc de la citoyenneté se pose aujourd’hui dans les termes suivants : à partir de quels critères l’individu va-t-il faire librement des choix qui ont un sens à ses yeux, dans un contexte culturel qui ne serait plus celui fourni par l’État-nation, chargé jusqu’ici de fournir à chacun, quelles que soient son origine, sa race ou sa religion, une mémoire collective et un projet commun, autrement dit les références partagées à partir desquelles un cadre politique est possible ?
Le multiculturalisme porte une nouvelle conception, où le « vivre ensemble » est réduit à un « vivre côte à côte » et l’idéal d’intégration réduit à la « tolérance » (du latin tolerare : « supporter »). Selon cette conception en réalité méfiante et négative à l’égard de celui qui est « différent », l’égalité et la liberté ne s’acquièrent plus par l’assimilation – qui met au second plan la différence ethnique ou religieuse au profit du « plébiscite de tous les jours » d’individus choisissant de faire partie d’une communauté d’Histoire et de destin – mais au contraire, par l’affirmation de cette différence en tant que source de normes spécifiques soustrayant l’individu à la loi commune, au projet commun et donc à la communauté nationale.
L’Europe serait mieux inspirer de renouer avec son identité, de retrouver les racines multiples et riches de la civilisation européenne et d’aller chercher en elle-même les moyens de son sursaut vital.
[1] Pour un aperçu introductif de la question multiculturelle aujourd’hui, v. P. Savidan, Le multiculturalisme, Que sais-je ?, 2011 ; A. Finkelkraut, L'identité malheureuse, Flammarion, 2013
II – Un pays a-t-il besoin d’une politique familiale ? L’exemple français
Un pays a-t-il besoin ou non de capital humain et en aura-t-il besoin demain ?
Ce n’est pas moi qui pose la question, c’est le grand démographe, le Professeur Gérard François Dumont. « Si un pays veut du capital humain, dit-il, il doit permettre à ses habitants d’avoir la liberté de choix dans le nombre d’enfants qu’ils souhaitent ». Or, aujourd’hui, ils ne l’ont pas.
Les Français, comme les Européens, n’ont pas tous les enfants qu’ils désireraient. Comment leur procurer cette liberté, et du même coup échapper à ce suicide démographique collectif ?
Par la « confiance », répondent les démographes. La confiance dans une politique familiale stable, soutenue et consensuelle dans la société.
Cette confiance est le secret, selon le Professeur Dumont, du taux de fécondité plus élevé que connait la France. Car la France a depuis l’après-guerre, à l’initiative du général de Gaulle inspiré par le démographe Alfred Sauvy, une tradition de politique familiale soutenue dans ses deux aspects : allocations financières et services pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Les résultats de cette politique ont été très positifs dans les dernières décennies. La fécondité en France notamment ne s’est pas effondrée comme dans les autres pays européens.
Elle est devenue supérieure d’un quart à cette moyenne depuis 1999, dans une Europe qui se trouve dans cet « hiver démographique ».
Le Professeur Dumont a étudié la corrélation entre les budgets consacrés aux politiques familiales dans les différents pays européens et les niveaux de fécondité.
Et le résultat est limpide :
Globalement les pays qui n’ont pratiquement pas de politique familiale sont ceux dont la fécondité est complètement effondrée, tandis que ceux qui ont une politique familiale significative sont ceux qui ont sur la durée le niveau de fécondité le plus élevé.
La consolidation de notre niveau de fécondité date de la fin des années 1990.
Il y a un deuxième élément de succès : le taux d’emploi des femmes y est le plus élevé d’Europe.
Si l’on compare avec l’Allemagne, la fécondité y est plus faible et le taux d’emploi des femmes très faible aussi. Pourtant, le budget de la politique familiale n’est pas négligeable. Le problème est qu’il est mal utilisé. L’Allemagne dépense beaucoup pour l’allocation premier enfant, ce qui a des effets assez limités du point de vue du soutien à la démographie. La baisse de pouvoir d’achat à partir du 2ème et 3ème enfant est plus significative qu’à partir du premier.
La conclusion est donc claire : là où il y a une politique familiale, il y a des familles. On le constate sur 50 ans d’évolution des politiques familiales en France et de la fécondité.
Aujourd’hui, la situation de quasi récession dans la zone euro, le niveau de l’endettement public, certains choix nationaux et européens catastrophiques pèsent, vous l’imaginez, sur les budgets de cette politique familiale.
Je pense notamment en France à la réduction du quotient familial et donc des allocations familiales pour certaines familles, après avoir envisagé le plafonnement ou la fiscalisation des allocations pour récupérer sur le dos des familles 300 euros par an en moyenne.
Ce serait à la fois une injustice et une erreur de raisonnement.
Une injustice d’abord. Parce que le débat sur le déficit de la branche famille est construit sur une réalité fausse. La caisse nationale d’allocation familiale n’est déficitaire qu’en apparence. D’après les ordonnances de 1967, chaque caisse sociale – santé, vieillesse, chômage, famille - devait être autonome. Mais les gouvernements n’ont pas respecté ces ordonnances. Les excédents des caisses d’allocation familiale ont été utilisés pour combler les autres caisses (maladie, vieillesse, chômage). Le budget famille a été la vache à lait du système de protection sociale. Dans des scénarios de croissance raisonnable on aurait de toutes façons un retour rapide et naturel à l’équilibre des comptes.
C’est une erreur de raisonnement ensuite, et je cite toujours le Pr Dumont, parce que ce dont ont besoin les couples pour mener leur projet d’enfant, c’est de sérénité, de confiance et donc de stabilité de cette politique.
Quand un couple a envie d’avoir un enfant, il ne fait pas de calculs financiers pour vérifier ce que ça va représenter exactement au centime près, en fonction des allocations familiales, en fonction du quotient familial etc.
La vraie question est de savoir si les familles ont confiance ou non dans la politique familiale qui est conduite par le pays. Or, si l’on prend des décisions qui adressent des signes négatifs et développent la méfiance dans la population, l’on en verra les effets en terme de fécondité.
Pourquoi la France a si peur de l’avenir a néanmoins une fécondité insuffisante mais plus élevée ? Parce qu’il y a un domaine dans lequel elle a eu jusqu’à un passé récent confiance : c’est la politique familiale.
La remise en cause de l’universalité des allocations familiales avait été décidé le 1er janvier 1998 mais cette décision a soulevé un torrent de protestations, y compris à gauche, parce qu’on remettait en cause le contrat social. Le gouvernement a dû faire marche arrière 9 mois après. Les Français se sont convaincus que la politique familiale ne pouvait pas être remise en cause.
De même qu’au plan local, les familles ne sont pas inquiètes en cas d’alternance politique parce qu’en France, du moins jusqu’à ces dernières années, la politique familiale était consensuelle.
Car cette politique familiale française est une politique multi-niveau, mise en œuvre par l’État, par les départements et par les communes, toutes tendances confondues et quelles que soient les alternances politiques départementales ou municipales.
Au plan local par exemple, certaines collectivités mettent en place des plans particulièrement ambitieux pour faciliter l’arrivée des jeunes couples, des jeunes familles dans la région et l’accueil de la petite enfance. Ils prévoient la multiplication des lieux d'accueil et des services à domicile et assurent aux femmes enceintes le déroulement serein de leur grossesse. Puéricultrices et médecins veillent à la santé de l'enfant après sa naissance et conseillent les jeunes mères. De même, des dizaines de crèches, micro-crèches, multi-accueils, haltes garderies, jardins d'éveil s’ouvrent pour constituer un véritable service public de la petite enfance.
Aujourd’hui, plutôt que de rogner sur les budgets des familles ou bricoler avec les paramètres du système en place et envoyer des signaux pouvant perturber la confiance, il faut investir – car c’est bien un investissement d’avenir – au profit des enfants.
Ce n’est pas moi qui pose la question, c’est le grand démographe, le Professeur Gérard François Dumont. « Si un pays veut du capital humain, dit-il, il doit permettre à ses habitants d’avoir la liberté de choix dans le nombre d’enfants qu’ils souhaitent ». Or, aujourd’hui, ils ne l’ont pas.
Les Français, comme les Européens, n’ont pas tous les enfants qu’ils désireraient. Comment leur procurer cette liberté, et du même coup échapper à ce suicide démographique collectif ?
Par la « confiance », répondent les démographes. La confiance dans une politique familiale stable, soutenue et consensuelle dans la société.
Cette confiance est le secret, selon le Professeur Dumont, du taux de fécondité plus élevé que connait la France. Car la France a depuis l’après-guerre, à l’initiative du général de Gaulle inspiré par le démographe Alfred Sauvy, une tradition de politique familiale soutenue dans ses deux aspects : allocations financières et services pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Les résultats de cette politique ont été très positifs dans les dernières décennies. La fécondité en France notamment ne s’est pas effondrée comme dans les autres pays européens.
Elle est devenue supérieure d’un quart à cette moyenne depuis 1999, dans une Europe qui se trouve dans cet « hiver démographique ».
Le Professeur Dumont a étudié la corrélation entre les budgets consacrés aux politiques familiales dans les différents pays européens et les niveaux de fécondité.
Et le résultat est limpide :
Globalement les pays qui n’ont pratiquement pas de politique familiale sont ceux dont la fécondité est complètement effondrée, tandis que ceux qui ont une politique familiale significative sont ceux qui ont sur la durée le niveau de fécondité le plus élevé.
La consolidation de notre niveau de fécondité date de la fin des années 1990.
Il y a un deuxième élément de succès : le taux d’emploi des femmes y est le plus élevé d’Europe.
Si l’on compare avec l’Allemagne, la fécondité y est plus faible et le taux d’emploi des femmes très faible aussi. Pourtant, le budget de la politique familiale n’est pas négligeable. Le problème est qu’il est mal utilisé. L’Allemagne dépense beaucoup pour l’allocation premier enfant, ce qui a des effets assez limités du point de vue du soutien à la démographie. La baisse de pouvoir d’achat à partir du 2ème et 3ème enfant est plus significative qu’à partir du premier.
La conclusion est donc claire : là où il y a une politique familiale, il y a des familles. On le constate sur 50 ans d’évolution des politiques familiales en France et de la fécondité.
Aujourd’hui, la situation de quasi récession dans la zone euro, le niveau de l’endettement public, certains choix nationaux et européens catastrophiques pèsent, vous l’imaginez, sur les budgets de cette politique familiale.
Je pense notamment en France à la réduction du quotient familial et donc des allocations familiales pour certaines familles, après avoir envisagé le plafonnement ou la fiscalisation des allocations pour récupérer sur le dos des familles 300 euros par an en moyenne.
Ce serait à la fois une injustice et une erreur de raisonnement.
Une injustice d’abord. Parce que le débat sur le déficit de la branche famille est construit sur une réalité fausse. La caisse nationale d’allocation familiale n’est déficitaire qu’en apparence. D’après les ordonnances de 1967, chaque caisse sociale – santé, vieillesse, chômage, famille - devait être autonome. Mais les gouvernements n’ont pas respecté ces ordonnances. Les excédents des caisses d’allocation familiale ont été utilisés pour combler les autres caisses (maladie, vieillesse, chômage). Le budget famille a été la vache à lait du système de protection sociale. Dans des scénarios de croissance raisonnable on aurait de toutes façons un retour rapide et naturel à l’équilibre des comptes.
C’est une erreur de raisonnement ensuite, et je cite toujours le Pr Dumont, parce que ce dont ont besoin les couples pour mener leur projet d’enfant, c’est de sérénité, de confiance et donc de stabilité de cette politique.
Quand un couple a envie d’avoir un enfant, il ne fait pas de calculs financiers pour vérifier ce que ça va représenter exactement au centime près, en fonction des allocations familiales, en fonction du quotient familial etc.
La vraie question est de savoir si les familles ont confiance ou non dans la politique familiale qui est conduite par le pays. Or, si l’on prend des décisions qui adressent des signes négatifs et développent la méfiance dans la population, l’on en verra les effets en terme de fécondité.
Pourquoi la France a si peur de l’avenir a néanmoins une fécondité insuffisante mais plus élevée ? Parce qu’il y a un domaine dans lequel elle a eu jusqu’à un passé récent confiance : c’est la politique familiale.
La remise en cause de l’universalité des allocations familiales avait été décidé le 1er janvier 1998 mais cette décision a soulevé un torrent de protestations, y compris à gauche, parce qu’on remettait en cause le contrat social. Le gouvernement a dû faire marche arrière 9 mois après. Les Français se sont convaincus que la politique familiale ne pouvait pas être remise en cause.
De même qu’au plan local, les familles ne sont pas inquiètes en cas d’alternance politique parce qu’en France, du moins jusqu’à ces dernières années, la politique familiale était consensuelle.
Car cette politique familiale française est une politique multi-niveau, mise en œuvre par l’État, par les départements et par les communes, toutes tendances confondues et quelles que soient les alternances politiques départementales ou municipales.
Au plan local par exemple, certaines collectivités mettent en place des plans particulièrement ambitieux pour faciliter l’arrivée des jeunes couples, des jeunes familles dans la région et l’accueil de la petite enfance. Ils prévoient la multiplication des lieux d'accueil et des services à domicile et assurent aux femmes enceintes le déroulement serein de leur grossesse. Puéricultrices et médecins veillent à la santé de l'enfant après sa naissance et conseillent les jeunes mères. De même, des dizaines de crèches, micro-crèches, multi-accueils, haltes garderies, jardins d'éveil s’ouvrent pour constituer un véritable service public de la petite enfance.
Aujourd’hui, plutôt que de rogner sur les budgets des familles ou bricoler avec les paramètres du système en place et envoyer des signaux pouvant perturber la confiance, il faut investir – car c’est bien un investissement d’avenir – au profit des enfants.
III - La politique familiale suffit-elle ?
Le contexte économique, social, culturel, l’ambiance générale d’un pays pèse sur le moral et la confiance des familles, des parents, et, à un degré ou un autre, sur leur choix de mettre un nouvel enfant au monde ou d’y renoncer.
Or, aujourd’hui l’économie européenne est plombée : plombée par la crise des dettes souveraines, plombée par une monnaie unique inadaptée, chère et qui n’a pas empêché la hausse des prix, plombée d’être l’union commerciale la moins protégée du monde, plombée par l’impuissance de gouvernements ayant renoncé aux instruments de relance par la consommation ou l’investissement. Voilà qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et leur confiance en l’avenir.
Pendant longtemps, une vision comptable et malthusienne du monde a vu dans la dénatalité européenne une aubaine pour l’emploi. Une telle conception est aussi à l’origine de la politique économique menée depuis trente ans en Europe et qui favorise la lutte contre l’inflation – ce qui n’a pas empêché pas les prix de flamber - plutôt que contre le chômage, c’est à dire la rente plutôt que la production et l’emploi. Le tout, avec la certitude que la dénatalité finira par ramener mécaniquement à la population vieillissante le plein emploi.
Ce sont bien les jeunes que les politiques publiques ont eu tendance à sacrifier en priorité depuis 30 ans.
Pourtant, par leur comportement économique dynamique, par la promesse qu’ils constituent pour l’avenir, ils devraient faire l’objet de toutes les attentions, de toutes les protections. Le sociologue Louis Chauvel a ainsi pu mettre en évidence, chiffres à l’appui, la dégradation continue des conditions de vie des générations nées après 1960 et davantage encore des moins de 35 ans. Il démontre comment ceux-ci « arrivent dans un monde déjà possédé » à tous les niveaux par leurs aînés. Les nouvelles générations ont inauguré en effet une époque de baisse du niveau de salaire relatif, de stagnation du niveau de vie (alors que celui des plus âgés s’élève), de hausse du coût du logement, de stagnation des départs en vacances et un niveau croissant de suicide et de mortalité. Il en conclut l’existence d’une fracture intergénérationnelle qui promet de s’amplifier dans les années qui viennent, risquant de « faire éclater le compromis entre générations » d’ici vingt ans.
Il faut en finir avec la gestion à courte-vue, en rappelant une vérité simple : c’est qu’il n’est pas d’exemple de développement durable qui s’appuie sur une population stagnante, engagée dans un processus accéléré de vieillissement.
Moins d’enfants, c’est moins de besoins en maternités, en crèches, en écoles, en équipements culturels et sportifs, en mètres carrés de logement, en équipement électroménager et audiovisuel, en automobiles etc... A l’inverse, plus de personnes âgées, c’est plus de ménages suréquipés et des besoins restreints. Avec un revenu identique, les retraités consomment par ailleurs beaucoup moins que les actifs et ce, malgré leur surconsommation médicale, tant leur propension à thésauriser est grande.
En outre, toutes les études démontrent que la chute de la fécondité n’est pas liée à une baisse de désir d’enfants mais aux difficultés économiques et sociales plus grandes que les couples rencontrent pour les élever.
Beaucoup souhaiteraient un troisième enfant, mais se heurtent à la perspective de devoir changer de logement, de perdre son emploi, d’une baisse du niveau de vie de la famille toute entière.
Cette politique familiale ambitieuse doit permettre aux couples d’avoir le nombre d’enfants de leur choix, réconciliant cette liberté individuelle qui devrait faire consensus au-delà des options politiques de chacun, avec le destin collectif de la nation, de la région.
De notre dynamisme démographique dépend non seulement le financement des retraites des générations futures, mais aussi la force d’initiative, d’adaptation et la vigueur économique de notre pays.
Pour mener cette grande politique familiale, les Etats, les régions, les communes d’Europe devraient opportunément suivre les conclusions de l’Avis du Comité économique et social européen sur « la famille et l’évolution démographique » adopté en 2007.
Il préconise notamment que les Etats membres signent un Pacte européen pour la famille :
Or, aujourd’hui l’économie européenne est plombée : plombée par la crise des dettes souveraines, plombée par une monnaie unique inadaptée, chère et qui n’a pas empêché la hausse des prix, plombée d’être l’union commerciale la moins protégée du monde, plombée par l’impuissance de gouvernements ayant renoncé aux instruments de relance par la consommation ou l’investissement. Voilà qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et leur confiance en l’avenir.
Pendant longtemps, une vision comptable et malthusienne du monde a vu dans la dénatalité européenne une aubaine pour l’emploi. Une telle conception est aussi à l’origine de la politique économique menée depuis trente ans en Europe et qui favorise la lutte contre l’inflation – ce qui n’a pas empêché pas les prix de flamber - plutôt que contre le chômage, c’est à dire la rente plutôt que la production et l’emploi. Le tout, avec la certitude que la dénatalité finira par ramener mécaniquement à la population vieillissante le plein emploi.
Ce sont bien les jeunes que les politiques publiques ont eu tendance à sacrifier en priorité depuis 30 ans.
Pourtant, par leur comportement économique dynamique, par la promesse qu’ils constituent pour l’avenir, ils devraient faire l’objet de toutes les attentions, de toutes les protections. Le sociologue Louis Chauvel a ainsi pu mettre en évidence, chiffres à l’appui, la dégradation continue des conditions de vie des générations nées après 1960 et davantage encore des moins de 35 ans. Il démontre comment ceux-ci « arrivent dans un monde déjà possédé » à tous les niveaux par leurs aînés. Les nouvelles générations ont inauguré en effet une époque de baisse du niveau de salaire relatif, de stagnation du niveau de vie (alors que celui des plus âgés s’élève), de hausse du coût du logement, de stagnation des départs en vacances et un niveau croissant de suicide et de mortalité. Il en conclut l’existence d’une fracture intergénérationnelle qui promet de s’amplifier dans les années qui viennent, risquant de « faire éclater le compromis entre générations » d’ici vingt ans.
Il faut en finir avec la gestion à courte-vue, en rappelant une vérité simple : c’est qu’il n’est pas d’exemple de développement durable qui s’appuie sur une population stagnante, engagée dans un processus accéléré de vieillissement.
Moins d’enfants, c’est moins de besoins en maternités, en crèches, en écoles, en équipements culturels et sportifs, en mètres carrés de logement, en équipement électroménager et audiovisuel, en automobiles etc... A l’inverse, plus de personnes âgées, c’est plus de ménages suréquipés et des besoins restreints. Avec un revenu identique, les retraités consomment par ailleurs beaucoup moins que les actifs et ce, malgré leur surconsommation médicale, tant leur propension à thésauriser est grande.
En outre, toutes les études démontrent que la chute de la fécondité n’est pas liée à une baisse de désir d’enfants mais aux difficultés économiques et sociales plus grandes que les couples rencontrent pour les élever.
Beaucoup souhaiteraient un troisième enfant, mais se heurtent à la perspective de devoir changer de logement, de perdre son emploi, d’une baisse du niveau de vie de la famille toute entière.
Cette politique familiale ambitieuse doit permettre aux couples d’avoir le nombre d’enfants de leur choix, réconciliant cette liberté individuelle qui devrait faire consensus au-delà des options politiques de chacun, avec le destin collectif de la nation, de la région.
De notre dynamisme démographique dépend non seulement le financement des retraites des générations futures, mais aussi la force d’initiative, d’adaptation et la vigueur économique de notre pays.
Pour mener cette grande politique familiale, les Etats, les régions, les communes d’Europe devraient opportunément suivre les conclusions de l’Avis du Comité économique et social européen sur « la famille et l’évolution démographique » adopté en 2007.
Il préconise notamment que les Etats membres signent un Pacte européen pour la famille :
- Pour mettre en place des politiques répondant au nombre d’enfants souhaités par les couples, avec prestations financières directes, adaptations fiscales et offres d’équipements publics ou privés
- Pour fixer un plancher de budgets publics – un minimum familial en quelque sorte – consacrés aux enfants et aux familles (afin d’éviter qu’ils ne soient laminés par la gérontocroissance sous l’influence d’un électorat vieillissant)
- Pour garantir un environnement favorable aux familles, aux mères, aux pères et aux enfants, notamment dans la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle tenant compte des modes de vie nouveaux (temps éclatés, distances, logements chers en centre ville, manque de services d’accueil de la petite enfance)
- Pour garantir et améliorer la santé, l’éducation et la sécurité des enfants – y compris, c'est moi qui l'ajoute, en développant une véritable écologie de l'image face aux écrans qui les bombardent en continu – la résorption du chômage massif – dont les jeunes, on ne le sait que trop ici en Espagne, sont les premières victimes
IV – L’Europe est-elle un niveau pertinent pour la famille et l’enfant ? Où placer le gouvernail ?
La politique familiale n’est pas une compétence de l'UE. Dans une approche fondée sur la subsidiarité, l'Union européenne devrait respecter la souveraineté des Etats et, conformément aux traités qui la fondent, qu’elle ne nuise pas à la diversité entre les États membres, sur l’organisation des sociétés, les différences entre nos cultures, nos traditions, nos approches philosophiques. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de Karsurhe dans son arrêt du 30 juin 2009.
L’Avis du CESE insiste fortement, et c’est le bon sens, pour que ces politiques familiales audacieuses qu’il appelle de ses vœux dans toute l’Europe restent des politiques nationales, régionales et locales, pour pouvoir toujours être différenciées, adaptées.
Pourtant, le droit européen, celui du Conseil de l’Europe en particulier, par la bouche des juges de la Cour européenne des droits de l’Homme, mais aussi celui de l’Union européenne par la voie de la Commission et du juge de Luxembourg s’est largement immiscé dans le droit des personnes et le droit de la famille, en dépit de l’absence de compétence explicite qui lui aurait été conférée par le traité.
On peut aujourd’hui parler d’une Européanisation subreptice du droit des personnes et de la famille.
L’Union s’y est impliquée à travers deux outils juridiques :
« l’interdiction du travail des enfants
Art. 7 de la Charte «Toute personne a droit au respect de sa (...) la vie privée et familiale. »
Art. 33.1 "La famille jouit d'une protection juridique, économique et sociale."
Aujourd’hui, de nombreuses directives, règlements et jurisprudence de la Cour de Luxembourg oeuvrent à la construction d’un Espace libre circulation des personnes et de leur statut familial : le Règlement dit Bruxelles 2 sur la compétence en matière de divorce et de responsabilité parentale, le Règlement aliments et le Règlement Rome 3 sur la loi applicable au divorce et de responsabilité parentale, bientôt le Règlement successions.
La voie est celle de la coordination des systèmes juridiques des Etats membres et la création de règles communes de conflit sur la compétence judiciaire ou la loi applicable.
Sans compétence, sans mandat, des travaux sont en cours à l’université d’Utrecht pour le rapprochement des droits de la famille au niveau européen, c’est-à-dire leur uniformisation progressive, en vue de l’intégrer à un jour à un code civil européen.
Avec la jurisprudence de la CJUE, ces textes ont des retentissements considérables sur l’institution familiale, sur la conception d’un droit des personnes et de la famille qui est de plus en plus soumis aux désirs individuels et à une idéologie en réalité très peu soucieuse de l’intérêt de l’enfant et de ses droits fondamentaux.
Dans le domaine familial, depuis les années 90, plusieurs outils ont été mis en place par l’Europe : une ligne budgétaire, un observatoire, un groupe de travail au sein de la Commission européenne, un groupe d'experts gouvernementaux, un intergroupe du Parlement européen sur la famille. Mais certains ont été abandonnés.
Depuis 2005, il ya eu un regain d’initiative mettant l'accent sur l’importance de répondre aux changements démographiques avec plusieurs communications de la Commission européenne.
D'autres politiques européenne qui influent indirectement familles : droit des immigrés au regroupement familial, les fonds sociaux (Fonds social européen), le logement, la fiscalité (TVA).
Dans le cadre de la politique d’emploi et de protection sociale, l’Europe encourage l’harmonisation et les bonnes pratiques dans certains domaines :
- La flexibilité du temps de travail pour permettre aux parents de s’occuper de leurs enfants
- Les structures d’accueil et de soins (processus de Barcelone, Conclusions du Conseil de Prague (2009).
- La prise de congé parental à tous les parents qui permet de s’absenter au moins 3 mois jusqu’à l’âge de 8 ans (directive 1996). En 2008 la Commission a proposé de le porter à 18 semaines et le Parlement à 20 semaines rémunérées.
Dans son Avis très volontariste, le CESE interpelle aussi les Etats, les collectivités, et chacun d’entre nous sur ce qu’il appelle « la culture dominante qui n’est pas favorable à la famille ni à l’accueil des enfants, avec le triomphe de l’individualisme et du matérialisme consumériste ».
A cet égard, comment ne pas regretter certaines initiatives prises au Parlement européen, pour tenter de libéraliser la maternité pour autrui, la procréation assistée pour les couples de même sexe, dénier aux médecins le droit fondamental à la liberté de conscience face à l'acte d'avortement ou promouvoir l’éducation sexuelle obligatoire dès la petite enfance ?
Comment ne pas s’inquiéter du lobbying malthusien de certains élus qui considère l’enfant comme nouveau générateur de CO2 et donc une menace pour l’environnement.
Une sorte de délire idéologique semble s’être emparé de certains élus, démontrant dans ce domaine comme dans d’autres, ce qu’est capable de produire un pouvoir déconnecté des peuples et du réel.
Alors oui, la famille, l’enfant, leurs libertés fondamentales, autrement dit l’avenir démographique du continent auraient dû, doivent rester absolument dans le champ national et local. Car il est des libertés fondamentales à protéger d'urgence devant l’extension sans fin du règne de la marchandise et du relativisme .
Je pense notamment à la liberté de ne pas travailler pour élever ses enfants au moyen d’une allocation parentale de libre choix donnant lieu à cotisations sociales, la liberté de ne pas travailler le dimanche, la liberté de choisir l’éducation de ses enfants, le droit d’être élevé par un père et une mère, etc.
"La famille a connu ces deux dernières décennies d’importantes secousses en Europe avec la précarité des unions, l’homoparentalité, les familles décomposées-recomposées. Tous ces changements sont le reflet d’une société résolument individualiste. Ils sont la traduction du démontage des institutions collectives avec la complicité souvent du pouvoir politique.
Lieu d’apprentissage, d’amour, de transmission des valeurs, de stabilité et de solidarité, cellule de base de nos pays et de nos sociétés, la famille est une communauté dont les Européens ne veulent pas se défaire.
Nos pays, nos régions, devraient pouvoir mener de concert et sans l'interférence supranationale, des politiques familiales dynamiques, stables, durables, qui renforcent la responsabilité et l’autorité des parents, préservent les droits de l’enfant et répondent à l’urgence démographique.
Jaime Semprun écrit « Quand le citoyen-écologiste croit poser la question la plus dérangeante en demandant « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? il évite de se poser cette autre question, réellement importante : A quels enfants allons nous laisser le monde ? »
Je vous remercie de votre attention.
CB
L’Avis du CESE insiste fortement, et c’est le bon sens, pour que ces politiques familiales audacieuses qu’il appelle de ses vœux dans toute l’Europe restent des politiques nationales, régionales et locales, pour pouvoir toujours être différenciées, adaptées.
Pourtant, le droit européen, celui du Conseil de l’Europe en particulier, par la bouche des juges de la Cour européenne des droits de l’Homme, mais aussi celui de l’Union européenne par la voie de la Commission et du juge de Luxembourg s’est largement immiscé dans le droit des personnes et le droit de la famille, en dépit de l’absence de compétence explicite qui lui aurait été conférée par le traité.
On peut aujourd’hui parler d’une Européanisation subreptice du droit des personnes et de la famille.
L’Union s’y est impliquée à travers deux outils juridiques :
- la Charte des droits fondamentaux : l'article 9 affirme explicitement que «le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales régissant l'exercice de ces droits ".
« l’interdiction du travail des enfants
Art. 7 de la Charte «Toute personne a droit au respect de sa (...) la vie privée et familiale. »
Art. 33.1 "La famille jouit d'une protection juridique, économique et sociale."
- la liberté de circulation au sein du marché intérieur.
Aujourd’hui, de nombreuses directives, règlements et jurisprudence de la Cour de Luxembourg oeuvrent à la construction d’un Espace libre circulation des personnes et de leur statut familial : le Règlement dit Bruxelles 2 sur la compétence en matière de divorce et de responsabilité parentale, le Règlement aliments et le Règlement Rome 3 sur la loi applicable au divorce et de responsabilité parentale, bientôt le Règlement successions.
La voie est celle de la coordination des systèmes juridiques des Etats membres et la création de règles communes de conflit sur la compétence judiciaire ou la loi applicable.
Sans compétence, sans mandat, des travaux sont en cours à l’université d’Utrecht pour le rapprochement des droits de la famille au niveau européen, c’est-à-dire leur uniformisation progressive, en vue de l’intégrer à un jour à un code civil européen.
Avec la jurisprudence de la CJUE, ces textes ont des retentissements considérables sur l’institution familiale, sur la conception d’un droit des personnes et de la famille qui est de plus en plus soumis aux désirs individuels et à une idéologie en réalité très peu soucieuse de l’intérêt de l’enfant et de ses droits fondamentaux.
Dans le domaine familial, depuis les années 90, plusieurs outils ont été mis en place par l’Europe : une ligne budgétaire, un observatoire, un groupe de travail au sein de la Commission européenne, un groupe d'experts gouvernementaux, un intergroupe du Parlement européen sur la famille. Mais certains ont été abandonnés.
Depuis 2005, il ya eu un regain d’initiative mettant l'accent sur l’importance de répondre aux changements démographiques avec plusieurs communications de la Commission européenne.
D'autres politiques européenne qui influent indirectement familles : droit des immigrés au regroupement familial, les fonds sociaux (Fonds social européen), le logement, la fiscalité (TVA).
Dans le cadre de la politique d’emploi et de protection sociale, l’Europe encourage l’harmonisation et les bonnes pratiques dans certains domaines :
- La flexibilité du temps de travail pour permettre aux parents de s’occuper de leurs enfants
- Les structures d’accueil et de soins (processus de Barcelone, Conclusions du Conseil de Prague (2009).
- La prise de congé parental à tous les parents qui permet de s’absenter au moins 3 mois jusqu’à l’âge de 8 ans (directive 1996). En 2008 la Commission a proposé de le porter à 18 semaines et le Parlement à 20 semaines rémunérées.
Dans son Avis très volontariste, le CESE interpelle aussi les Etats, les collectivités, et chacun d’entre nous sur ce qu’il appelle « la culture dominante qui n’est pas favorable à la famille ni à l’accueil des enfants, avec le triomphe de l’individualisme et du matérialisme consumériste ».
A cet égard, comment ne pas regretter certaines initiatives prises au Parlement européen, pour tenter de libéraliser la maternité pour autrui, la procréation assistée pour les couples de même sexe, dénier aux médecins le droit fondamental à la liberté de conscience face à l'acte d'avortement ou promouvoir l’éducation sexuelle obligatoire dès la petite enfance ?
Comment ne pas s’inquiéter du lobbying malthusien de certains élus qui considère l’enfant comme nouveau générateur de CO2 et donc une menace pour l’environnement.
Une sorte de délire idéologique semble s’être emparé de certains élus, démontrant dans ce domaine comme dans d’autres, ce qu’est capable de produire un pouvoir déconnecté des peuples et du réel.
Alors oui, la famille, l’enfant, leurs libertés fondamentales, autrement dit l’avenir démographique du continent auraient dû, doivent rester absolument dans le champ national et local. Car il est des libertés fondamentales à protéger d'urgence devant l’extension sans fin du règne de la marchandise et du relativisme .
Je pense notamment à la liberté de ne pas travailler pour élever ses enfants au moyen d’une allocation parentale de libre choix donnant lieu à cotisations sociales, la liberté de ne pas travailler le dimanche, la liberté de choisir l’éducation de ses enfants, le droit d’être élevé par un père et une mère, etc.
"La famille a connu ces deux dernières décennies d’importantes secousses en Europe avec la précarité des unions, l’homoparentalité, les familles décomposées-recomposées. Tous ces changements sont le reflet d’une société résolument individualiste. Ils sont la traduction du démontage des institutions collectives avec la complicité souvent du pouvoir politique.
Lieu d’apprentissage, d’amour, de transmission des valeurs, de stabilité et de solidarité, cellule de base de nos pays et de nos sociétés, la famille est une communauté dont les Européens ne veulent pas se défaire.
Nos pays, nos régions, devraient pouvoir mener de concert et sans l'interférence supranationale, des politiques familiales dynamiques, stables, durables, qui renforcent la responsabilité et l’autorité des parents, préservent les droits de l’enfant et répondent à l’urgence démographique.
Jaime Semprun écrit « Quand le citoyen-écologiste croit poser la question la plus dérangeante en demandant « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? il évite de se poser cette autre question, réellement importante : A quels enfants allons nous laisser le monde ? »
Je vous remercie de votre attention.
CB

 A la Une
A la Une









 A quels enfants allons nous laisser le monde ?
A quels enfants allons nous laisser le monde ?