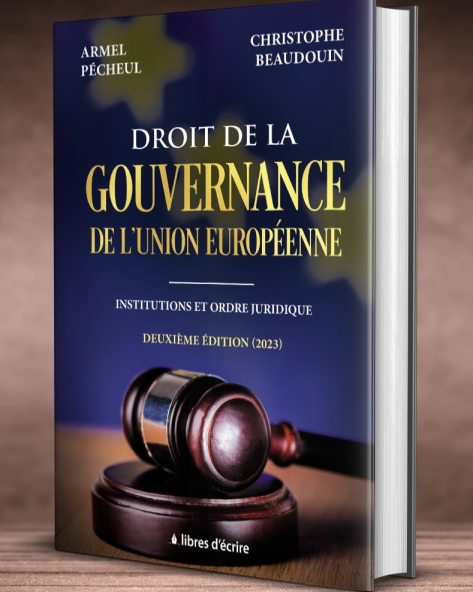« Le plus petit fonctionnaire européen est devenu le Maître de l’Union ! »
Le Traité de Lisbonne n’est pas un bon Traité. Très complexe, il introduit davantage d’opacité et crée des procédures qui ne sont plus uniformes comme par le passé, mais adaptables d’un acte de base à l’autre. Ces nouvelles procédures ad hoc - on pourrait dire à la carte – incitent le législateur à interpréter les règles pour les plier à sa volonté. Un législateur qui interprète le droit, ce n’est jamais bon signe !
Depuis début 2010, date de parution de mon petit livre sur la « Comitologie, le pouvoir européen confisqué », j’ai été amené à m’interroger sur la méthode communautaire, l’équilibre des pouvoirs et l’ordre juridique européen
Mais d’abord qu’est-ce qu’un ordre juridique ?
Proposer une bonne définition à ce concept très clair en apparence n’est pas chose aisée. Après maintes recherches, la réflexion la plus convaincante nous vient … du Canada. Guy Rocher, Professeur titulaire à Harvard et à l’Université Laval estime qu’un ordre juridique recouvre un « ensemble de règles contraignantes dont l’adoption est fondée sur la légitimité. Les règles et les agents doivent faire l’objet de stabilité dans le temps, d’une relative permanence ».
Il est clair que l’instabilité institutionnelle dans laquelle l’Union européenne vit depuis plus de 10 ans est à elle seule un facteur d’instabilité juridique. Rappelons en un mot la longue liste des réformes : projet de Traité constitutionnel, réforme de la comitologie en 2006, traité de Lisbonne fin 2009, nouvelle réforme de la comitologie pour les actes d’exécution en 2011.
Le mauvais exemple est venu des plus hautes autorités de l’Union
Les bouleversements institutionnels, économiques et monétaires ayant affecté l’Union européenne depuis 2008 sont, sans doute, à l’origine d’une sorte de « libre interprétation » de l’ordre juridique européen comme si l’urgence ou la gravité constituaient des raisons suffisantes pour adapter le droit aux circonstances.
Trois exemples viennent ici à l’esprit : l’adoption du paquet énergie-climat en décembre 2008 avec une mise à l’écart du Parlement et du Conseil des Ministres au bénéfice du Conseil européen des chefs d’Etat ou de gouvernement qui à l’époque n’avait pas le statut d’une Institution.
Le couple Merkel-Sarkozy démantelant la méthode communautaire au profit de l’inter-gouvernemental constitue un second exemple frappant. Le troisième exemple tenant aux batailles entre la Commission, le Parlement et le Conseil pour la répartition à leur avantage respectif des mesures d’exécution entre actes délégués et actes d’exécution.
Ce mauvais exemple a contaminé le processus de décision communautaire
Trois exemples parmi d’autres révèlent une tendance à de mauvaises pratiques procédurales : des habillages juridiques, raccourcis de procédure, approximations, interprétations des règles, … et à un manque de respect évident de l’esprit des Traités.
Premier cas : la directive sur la qualité des carburants. Dans ce dossier, la lettre des Traités est respectée, mais leur esprit détourné. Qu’il s’agisse de l’étude d’impact, de la consultation, de l’inscription au registre de la comitologie, des propositions alternatives des Etats membres, de la procédure inter-services, tout n’est que stop and go, vérités successives et opacité.
Deuxième cas : la révision de la directive sur la pharmacovigilance dans lequel on trouve à la fois une Procédure de Règlementation Avec Contrôle et des actes délégués. Or ces deux procédures ne peuvent pas coexister dans un même acte, l’une s’appliquant pour les actes antérieurs au Traité de Lisbonne, l’autre pour les actes postérieurs. Les juristes de la Commission justifient cette anomalie en estimant que l’on peut adapter les règles si elles facilitent l’obtention d’un compromis politique.
Troisième cas : ORPHACOL ou la négation des mesures d’exécution ! Voici un médicament évitant les greffes de foie chez les très jeunes enfants dont la mise sur le marché a été approuvée à deux reprises - et à l’unanimité – par l’Agence Européenne des Médicaments. La Commission s’y oppose et rédige un projet de règlement refusant la mise sur le marché. Comité d’examen et Comité d’appel : dans les deux cas, les Etats membres s’opposent à la Commission à la majorité qualifiée. La Commission persiste dans son refus.
Le dossier est soumis à la Cour de Justice qui accepte la procédure d’urgence. Une semaine après l’audience devant la Cour, la Commission saisit à nouveau le Comité d’examen et lui représente le 8 mai 2012 (jour férié dans plusieurs pays) son projet de règlement initial. Ce même projet, que ce même Comité d’examen avait repoussé à la majorité qualifié le 13 octobre 2011 ! A quelques voix près, les Etats membres ne parviennent pas à réunir une majorité qualifiée, la Commission est désormais en mesure d’imposer le refus du médicament. On attend avec impatience les conclusions de la Cour.
Le dossier ORPHACOL. Une combinaison d’opacité et d’habillage juridique qui pose une vraie question : à Bruxelles aujourd’hui qui est le patron ?
Voici près de 40 ans que je pratique les Institutions européennes et je n’ai jamais vu un tel cas qui cumule tous les ingrédients d’une mauvaise gouvernance. D’abord, une opacité sur les motivations de la DG SANCO. Pourquoi une telle obstination à l’encontre d’un médicament qui a fait ses preuves depuis 20 ans et dont la mise sur le marché est soutenue par les plus hautes autorités médicales y compris par l’Agence Européenne des Médicaments à l’unanimité ?
Comment – ensuite – admettre le refus de la Commission de suivre la volonté des Etats-membres exprimée deux fois à la majorité qualifiée d’autoriser la mise sur le marché d’ORPHACOL ? Pire, la Commission représente un nouveau projet de règlement contre la mise sur le marché sans attendre le jugement de la Cour de justice attendu dans les prochaines semaines ?
« Le plus petit fonctionnaire européen est devenu le Maître de l’Union ». C’est ce à quoi fait penser le dossier ORPHACOL. Où est la méthode communautaire et la collégialité des décisions ?
Au fond à Bruxelles qui est le patron ? C’est la seule question à laquelle il importe aujourd’hui de répondre. Il convient, me semble-t-il de revenir d’urgence à la méthode communautaire qui passe par une Commission forte. Mais il ne saurait y avoir de Commission forte sans un respect absolu du couple Parlement/Conseil et sans une autorité hiérarchique puissante qui recadre les volontés hégémoniques de certaines Directions générales.
Daniel Guéguen est professeur de comitologie au Collège d'Europe. Il est également le président et un partenaire de PACT European Affairs, ainsi que le fondateur de CLAN Public Affairs.
publié sur http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/menaces-sur-ordre-juridique-euro-analysis-512906
Depuis début 2010, date de parution de mon petit livre sur la « Comitologie, le pouvoir européen confisqué », j’ai été amené à m’interroger sur la méthode communautaire, l’équilibre des pouvoirs et l’ordre juridique européen
Mais d’abord qu’est-ce qu’un ordre juridique ?
Proposer une bonne définition à ce concept très clair en apparence n’est pas chose aisée. Après maintes recherches, la réflexion la plus convaincante nous vient … du Canada. Guy Rocher, Professeur titulaire à Harvard et à l’Université Laval estime qu’un ordre juridique recouvre un « ensemble de règles contraignantes dont l’adoption est fondée sur la légitimité. Les règles et les agents doivent faire l’objet de stabilité dans le temps, d’une relative permanence ».
Il est clair que l’instabilité institutionnelle dans laquelle l’Union européenne vit depuis plus de 10 ans est à elle seule un facteur d’instabilité juridique. Rappelons en un mot la longue liste des réformes : projet de Traité constitutionnel, réforme de la comitologie en 2006, traité de Lisbonne fin 2009, nouvelle réforme de la comitologie pour les actes d’exécution en 2011.
Le mauvais exemple est venu des plus hautes autorités de l’Union
Les bouleversements institutionnels, économiques et monétaires ayant affecté l’Union européenne depuis 2008 sont, sans doute, à l’origine d’une sorte de « libre interprétation » de l’ordre juridique européen comme si l’urgence ou la gravité constituaient des raisons suffisantes pour adapter le droit aux circonstances.
Trois exemples viennent ici à l’esprit : l’adoption du paquet énergie-climat en décembre 2008 avec une mise à l’écart du Parlement et du Conseil des Ministres au bénéfice du Conseil européen des chefs d’Etat ou de gouvernement qui à l’époque n’avait pas le statut d’une Institution.
Le couple Merkel-Sarkozy démantelant la méthode communautaire au profit de l’inter-gouvernemental constitue un second exemple frappant. Le troisième exemple tenant aux batailles entre la Commission, le Parlement et le Conseil pour la répartition à leur avantage respectif des mesures d’exécution entre actes délégués et actes d’exécution.
Ce mauvais exemple a contaminé le processus de décision communautaire
Trois exemples parmi d’autres révèlent une tendance à de mauvaises pratiques procédurales : des habillages juridiques, raccourcis de procédure, approximations, interprétations des règles, … et à un manque de respect évident de l’esprit des Traités.
Premier cas : la directive sur la qualité des carburants. Dans ce dossier, la lettre des Traités est respectée, mais leur esprit détourné. Qu’il s’agisse de l’étude d’impact, de la consultation, de l’inscription au registre de la comitologie, des propositions alternatives des Etats membres, de la procédure inter-services, tout n’est que stop and go, vérités successives et opacité.
Deuxième cas : la révision de la directive sur la pharmacovigilance dans lequel on trouve à la fois une Procédure de Règlementation Avec Contrôle et des actes délégués. Or ces deux procédures ne peuvent pas coexister dans un même acte, l’une s’appliquant pour les actes antérieurs au Traité de Lisbonne, l’autre pour les actes postérieurs. Les juristes de la Commission justifient cette anomalie en estimant que l’on peut adapter les règles si elles facilitent l’obtention d’un compromis politique.
Troisième cas : ORPHACOL ou la négation des mesures d’exécution ! Voici un médicament évitant les greffes de foie chez les très jeunes enfants dont la mise sur le marché a été approuvée à deux reprises - et à l’unanimité – par l’Agence Européenne des Médicaments. La Commission s’y oppose et rédige un projet de règlement refusant la mise sur le marché. Comité d’examen et Comité d’appel : dans les deux cas, les Etats membres s’opposent à la Commission à la majorité qualifiée. La Commission persiste dans son refus.
Le dossier est soumis à la Cour de Justice qui accepte la procédure d’urgence. Une semaine après l’audience devant la Cour, la Commission saisit à nouveau le Comité d’examen et lui représente le 8 mai 2012 (jour férié dans plusieurs pays) son projet de règlement initial. Ce même projet, que ce même Comité d’examen avait repoussé à la majorité qualifié le 13 octobre 2011 ! A quelques voix près, les Etats membres ne parviennent pas à réunir une majorité qualifiée, la Commission est désormais en mesure d’imposer le refus du médicament. On attend avec impatience les conclusions de la Cour.
Le dossier ORPHACOL. Une combinaison d’opacité et d’habillage juridique qui pose une vraie question : à Bruxelles aujourd’hui qui est le patron ?
Voici près de 40 ans que je pratique les Institutions européennes et je n’ai jamais vu un tel cas qui cumule tous les ingrédients d’une mauvaise gouvernance. D’abord, une opacité sur les motivations de la DG SANCO. Pourquoi une telle obstination à l’encontre d’un médicament qui a fait ses preuves depuis 20 ans et dont la mise sur le marché est soutenue par les plus hautes autorités médicales y compris par l’Agence Européenne des Médicaments à l’unanimité ?
Comment – ensuite – admettre le refus de la Commission de suivre la volonté des Etats-membres exprimée deux fois à la majorité qualifiée d’autoriser la mise sur le marché d’ORPHACOL ? Pire, la Commission représente un nouveau projet de règlement contre la mise sur le marché sans attendre le jugement de la Cour de justice attendu dans les prochaines semaines ?
« Le plus petit fonctionnaire européen est devenu le Maître de l’Union ». C’est ce à quoi fait penser le dossier ORPHACOL. Où est la méthode communautaire et la collégialité des décisions ?
Au fond à Bruxelles qui est le patron ? C’est la seule question à laquelle il importe aujourd’hui de répondre. Il convient, me semble-t-il de revenir d’urgence à la méthode communautaire qui passe par une Commission forte. Mais il ne saurait y avoir de Commission forte sans un respect absolu du couple Parlement/Conseil et sans une autorité hiérarchique puissante qui recadre les volontés hégémoniques de certaines Directions générales.
Daniel Guéguen est professeur de comitologie au Collège d'Europe. Il est également le président et un partenaire de PACT European Affairs, ainsi que le fondateur de CLAN Public Affairs.
publié sur http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/menaces-sur-ordre-juridique-euro-analysis-512906

 A la Une
A la Une









 Menaces sur l’ordre juridique européen : qui est le patron à Bruxelles ?
Menaces sur l’ordre juridique européen : qui est le patron à Bruxelles ?